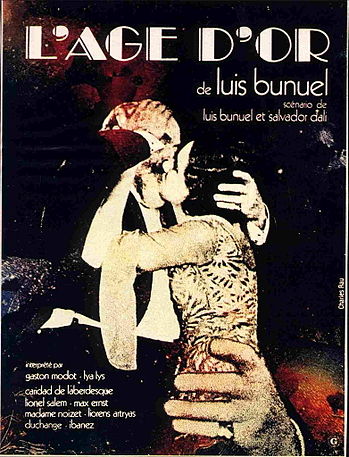Le septième art est un étrange concentré de vie : né il y a maintenant un peu plus d'un siècle, d'abord muet, puis parlant, puis en couleur, il a sa propre histoire et a parfois (souvent) été mêlé à la « grande » histoire (politique, sociologique, économique...), mais il a toujours fait appel à ces mêmes émotions qui définissent l'art au sens général du terme. En regardant ses films je m'embarque dans une merveilleuse machine à remonter le temps et je vais, ici, essayer de me poser dans les lieux parfois très différents où il m'a amené. Mon « plan de vol » est simple : la chronologie film par film année par année sera mon fil conducteur mais le choix des lieux d'escale est entièrement de mon ressort : pas question d'être malhonnête, d'autant que je ne suis ni un critique, ni un scénariste, ni un universitaire... Aussi je ne vais pas faire d'emblée mystère de mes intentions : j'aime particulièrement certains genres, acteurs ou réalisateurs, alors que je suis très hermétique à d'autres... Pour autant j'essaierai d'être le plus éclectique possible et de minimiser autant que possible les oublis. Pour autant je sais déjà que j'oublierai certains réalisateurs faute d'avoir été estomaqué par UN film en particulier... Mais pour l'heure il est temps de m'embarquer vers le premier des quatre continents de ce monde à-travers mes yeux : L’Ère du Muet... Voulez-vous être mes passagers?..

Les irréductibles de Lost
Forum pour les nostalgiques et passionnés de la série Lost. Venez partager vos analyses et théories, parler mythologie, histoire, géographie, littérature, musique...
Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous
1 Mon cinéma à-travers les temps Dim 27 Aoû 2017 - 4:23
Mon cinéma à-travers les temps Dim 27 Aoû 2017 - 4:23
Sudena
« Qui suis-je ?.. » : cette question hante bien souvent les âmes, surtout aux moments de calme où le temps, suspendu, rend la traditionnelle « Que dois-je faire ?.. » pour le moins étroite... Il n'existe, je pense, aucune réponse définitive à cette question, mais des souvenirs diffus, des bribes de sensations, des fulgurances de réflexions, peuvent permettre de jeter un peu de clarté dans cette nuit, et peut-être de renouer avec une certaine sérénité. Le sens des choses ? je n'y crois qu'à moitié... J'ai plutôt l'impression qu'il y a plusieurs sens à une même chose et qu'il ne faut pas avoir peur sinon de les explorer du moins de les accepter. Mais il existe entre nous une constante qui nous unit, constante qui a traversé les âges et que la modernité n'a ni changé ni relativisé : les émotions. Douces ou violentes, concernant divers objets, radialement opposées devant un même fait, mais toujours présentes... C'est à elles que je fais appel ici, car, en en ayant un besoin vital qu'il me faut constamment ranimer sous peine de dépérir, je n'ai pas trouvé meilleur « shoot » que le cinéma...
Le septième art est un étrange concentré de vie : né il y a maintenant un peu plus d'un siècle, d'abord muet, puis parlant, puis en couleur, il a sa propre histoire et a parfois (souvent) été mêlé à la « grande » histoire (politique, sociologique, économique...), mais il a toujours fait appel à ces mêmes émotions qui définissent l'art au sens général du terme. En regardant ses films je m'embarque dans une merveilleuse machine à remonter le temps et je vais, ici, essayer de me poser dans les lieux parfois très différents où il m'a amené. Mon « plan de vol » est simple : la chronologie film par film année par année sera mon fil conducteur mais le choix des lieux d'escale est entièrement de mon ressort : pas question d'être malhonnête, d'autant que je ne suis ni un critique, ni un scénariste, ni un universitaire... Aussi je ne vais pas faire d'emblée mystère de mes intentions : j'aime particulièrement certains genres, acteurs ou réalisateurs, alors que je suis très hermétique à d'autres... Pour autant j'essaierai d'être le plus éclectique possible et de minimiser autant que possible les oublis. Pour autant je sais déjà que j'oublierai certains réalisateurs faute d'avoir été estomaqué par UN film en particulier... Mais pour l'heure il est temps de m'embarquer vers le premier des quatre continents de ce monde à-travers mes yeux : L’Ère du Muet... Voulez-vous être mes passagers?..
Le septième art est un étrange concentré de vie : né il y a maintenant un peu plus d'un siècle, d'abord muet, puis parlant, puis en couleur, il a sa propre histoire et a parfois (souvent) été mêlé à la « grande » histoire (politique, sociologique, économique...), mais il a toujours fait appel à ces mêmes émotions qui définissent l'art au sens général du terme. En regardant ses films je m'embarque dans une merveilleuse machine à remonter le temps et je vais, ici, essayer de me poser dans les lieux parfois très différents où il m'a amené. Mon « plan de vol » est simple : la chronologie film par film année par année sera mon fil conducteur mais le choix des lieux d'escale est entièrement de mon ressort : pas question d'être malhonnête, d'autant que je ne suis ni un critique, ni un scénariste, ni un universitaire... Aussi je ne vais pas faire d'emblée mystère de mes intentions : j'aime particulièrement certains genres, acteurs ou réalisateurs, alors que je suis très hermétique à d'autres... Pour autant j'essaierai d'être le plus éclectique possible et de minimiser autant que possible les oublis. Pour autant je sais déjà que j'oublierai certains réalisateurs faute d'avoir été estomaqué par UN film en particulier... Mais pour l'heure il est temps de m'embarquer vers le premier des quatre continents de ce monde à-travers mes yeux : L’Ère du Muet... Voulez-vous être mes passagers?..
2 Re: Mon cinéma à-travers les temps Dim 27 Aoû 2017 - 19:32
Re: Mon cinéma à-travers les temps Dim 27 Aoû 2017 - 19:32
Sunil
Administrateur
Ouiii !!!Sudena a écrit:Voulez-vous être mes passagers?..
3 Re: Mon cinéma à-travers les temps Lun 28 Aoû 2017 - 14:37
Re: Mon cinéma à-travers les temps Lun 28 Aoû 2017 - 14:37
Sudena
L’Ère du Muet
Le cinéma en tant que technique naît en France, en 1895, avec l'invention des frères Lumière qui réalisent ainsi les premiers reportages (de quelques secondes) en filmant la sortie des ouvriers de leur usine et la fameuse Arrivée du Train en gare de la Ciotat : sans même le savoir ils sont à l'origine du cinéma documentaire... Mais l'homme qui utilisa cette technique de façon très « consciente », à des fins artistiques, fut Georges Méliès, reconnu depuis comme le vrai père du cinéma... Dans son théâtre ou chez lui, aidé par son flair et son imagination, Méliès sème les graines du cinéma : il crée en quelque sorte son alphabet et pose les bases de beaucoup de ses genres. Le Voyage dans la Lune, en 1902, est considéré (de façon certainement abusive) comme la première œuvre du cinéma de fiction, mais Méliès, qui avait par hasard découvert la possibilité de « truquer » l'image via la caméra (inventant par là l'effet spécial) invente aussi la comédie, la chronique familiale...et même le premier film politique avec L'Affaire Dreyfus en 1899 où il affirme son engagement dreyfusard... Ces films, qui poussent plusieurs particuliers à se lancer aussi dans cette nouvelle aventure, demeurent pour autant très « figés » au niveau des plans avec une caméra observant une « distance théâtre » certaine ; mais, surtout, ils déclenchent l'ire de l'intelligentsia en raison de leur côté « amusette » et du fait que ce sont souvent des amateurs aventuriers qui tentent leur chance...avec un jeu « débridé » à la clownerie assumée. Aussi certains grands noms artistiques de l'époque (les comédiens Charles Le Bargy, Albert Lambert, André Calmettes, le compositeur Camille Saint-Saëns...) tentent, en 1908, de donner une « légitimité artistique » à cette nouveauté avec un sujet sérieux, des mouvements lents, des costumes « dignes »...et le résultat est positivement catastrophique. L'Assassinat du duc de Guise est en-effet un monument du ridicule avec ses plans répétitifs, son jeu totalement outrancier (car non : bouger plus lentement n'est en aucun cas une garantie contre le « surjeu »...), son sujet « survolé »... Pire encore : son casting prestigieux et son côté nouveauté en fit un certain succès qui berna quelques temps les imposteurs...avant que l'enthousiasme ne retombe comme un mauvais soufflé et que les premières critiques osent enfin dire que, décidément, le cinéma n'est pas le théâtre et que le jeu d'acteurs y est obligatoirement différent. Oser dire ça était néanmoins assez aisé car, en même temps que la France fondait ses propres studios et salles de projection (le cinéma français était, de loin, le plus puissant du monde à cette époque), et que l'Italie, refusant d'être en reste, créait les bases du peplum, cet art nouveau trouvait son deuxième vrai créateur en Amérique en la personne de D.W. Griffith...
D.W. Griffith est un génie, un vrai de vrai ! Venu du Sud profond et d'un milieu extrêmement réactionnaire qu'il fit sien plus souvent qu'à son tour (j'y reviendrai dans très peu de temps), il était également fasciné par la nouveauté, qu'elle soit artistique, technique...ou idéologique. Aussi se lança-t-il rapidement, sans complexes ni illusions, dans le cinéma et se mit sur les traces de Georges Méliès (à ce moment-là comme plus tard, il refusa toujours d'être considéré comme un génie ou même un inventeur, affirmant qu'il devait tout à Méliès...) : important bien évidemment les histoires dans le contexte de son pays, il inventa (ou confirma) les deux genres typiquement américains que sont le western et le film de gangsters. Mais il alla plus loin, beaucoup plus loin, et là où il faut voir en Griffith un génie ET un inventeur, c'est dans son talent de conteur via les images : il savait comment créer de l'émotion dans ses films, d'abord en choisissant des acteurs au jeu « sobre » (particulièrement l'impeccable Henry B. Walthall sur lequel nous reviendrons), mais surtout en montant ses histoires et en utilisant le potentiel de sa caméra : c'est lui qui créa la profondeur de champ, qui sut alterner judicieusement plans larges/plans serrés, qui inventa le travelling, le panoramique, les caches, les fondus, les ouvertures/fermetures à l'iris... Aussi, si c'est bien Méliès qui a créé « l'alphabet » cinématographique, c'est Griffith qui en a inventé la « grammaire » et le « vocabulaire ». Néanmoins toutes ces productions étaient d'une durée très limitée et semblaient devoir se contenter d'un statut semblable aux spectacles de marionnettes qui, avec la photographie, avaient été leurs origines directes... Pourtant, en 1915, Griffith ose proposer autre-chose et tente un pari fou : c'est à cet endroit que je vais me poser pour notre première escale...
4 Re: Mon cinéma à-travers les temps Mar 29 Aoû 2017 - 12:06
Re: Mon cinéma à-travers les temps Mar 29 Aoû 2017 - 12:06
Sudena
Naissance d'une Nation
D.W. Griffith; 1915
D.W. Griffith; 1915
Alors que le monde est en guerre et découvre l'horreur des massacres de masse et des attaques au gaz asphyxiant, D.W. Griffith s'apprête à signer le film le plus important de l'histoire du cinéma : son premier long métrage, sa première « fresque » où il va, plus de trois heures durant, servir au spectateur un concentré de toutes les techniques qu'il a lui-même inventées au service d'une histoire passionnante et au-combien américaine : la Guerre de Sécession et ses conséquences. Si le scénario de base est bien un livre (The Clansman de Thomas Dixon), ce qui frappe le plus lorsqu'on voit Naissance d'une Nation aujourd'hui est l'efficacité foudroyante avec laquelle il est narré : l'alternance permanente plans larges/plans serrés, l'utilisation judicieuse des caches et de l'iris, le montage alterné dans les scènes les plus marquantes, la couleur de pellicule, les fondus et (encore rares) panoramiques, sont « mixés » avec une justesse à faire pâlir d'envie les réalisateurs les plus chevronnés, chose d'autant plus remarquable que le style n'est jamais « narcissique » et sert le propos en permanence. L'exemple le plus marquant est sans aucun doute la fameuse scène de l'assassinat de Lincoln : alternant les plans larges de l'euphorie ambiante, puis passant aux gros plans sur la faciès maléfique de Booth (joué, soit dit en passant, par un futur très grand nom de la Warner : mr Raoul Walsh...) puis sur un cache dévoilant son revolver, pour revenir ensuite sur le plan large de la salle et ainsi de suite jusqu'au coup de feu fatal, cette scène est tellement bien réalisée qu'aujourd'hui elle symbolise cet assassinat dans l'inconscient collectif... En l'évoquant, j'ai très légèrement abordé deux sujets capitaux : la distribution et le massage sous-jacent. Parlons-en donc...
Le casting peut, par moments, sembler un peu déséquilibré, mais force est de reconnaître que, dans l'ensemble, il tient bigrement la route. Dans les rôles principaux, si on peut légitimement reprocher à Mae Marsh et (à un moindre niveau) à Lillian Gish d'en faire un peu trop (la deuxième surtout dans les scènes d'émotions violentes car elle est, en-revanche, très juste dans les scènes « calmes » et nuancées...), leur énergie est remarquablement contrebalancée par une Miriam Cooper toute en délicatesse et en sobriété, mais l'atout plus de cette distribution est indiscutablement Henry B. Walthall dans le rôle principal : l'acteur incarne son personnage à la fois de soldat, de gentleman et d'être humain accablé par le sort avec brio, toujours très charismatique mais jamais dans l'excès (ou presque : il est d'ailleurs rigolo de constater que les seules scènes où il en fait un peu trop sont filmées en plans larges, comme si la caméra rapprochée le rassurait quant à son talent...).
Hélas, toutes ces merveilles servent un message hautement nauséabond où la face « sudiste » du réalisateur apparaît dans toute son horreur... Le début, déjà, n'augure rien de bon : les Noirs sont présentés comme des attardés mentaux réagissant comme du bétail...et la suite va nous les montrer au mieux manipulables, souvent monstrueux, à l'exception bien sûr des gentils esclaves fidèles qui aideront sans relâche leurs maîtres Blancs. Pourtant la première partie demeure ambiguë : les deux familles principales, les Cameron et les Stoneman, sont pour la première sudiste pour la deuxième nordiste, mais sont unies par une indéfectible amitié qui rendra leur guerre particulièrement odieuse (le comble sera atteint lors de la scène de la mort des deux fils cadets dont l'amitié est présentée comme fusionnelle...sinon charnelle). De plus, si Griffith est de toute évidence un sudiste, il n'est manifestement pas un sécessionniste (à l'image de son personnage principal), pour preuve à la fois le vocabulaire « nordiste » au moment de désigner les batailles (il parle de celle de « Bull Run » que les confédérés appellent « Mannassas ») et surtout la façon de montrer Abraham Lincoln, véritable figure christique d'une bonté et d'une humanité sans limite... Mais l'impression de gène déjà palpable se confirme dans la deuxième partie qui a fait scandale dès la sortie du film et qui montre comment les Noirs, manipulés par des mulâtres ambitieux et sans scrupules, ont tenté d'imposer un pouvoir dictatorial aux pauvres anciens maître Blancs vaincus lesquels, pour sauver leur vie et leur honneur, n'ont eu d'autre choix que de s'organiser en une société secrète, constituée de chevaliers sans peur et sans reproche et qui a sauvé la Nation : le Ku Klux Klan. C'est immonde ! C'est honteux ! C'est vomitif ! Et c'est pourtant bigrement génial !.. La montée en puissance finale, lorsque, pour sauver de la horde des Noirs sanguinaires leurs familles, amis et amantes, les chevaliers du Klan arrivent semblables au torrent, de plus en plus nombreux, et réussissent in-extremis leur mission, est tout à fait caractéristique de l'ambivalence de ce film : le fond est si ignoble qu'il donne des envies de meurtre ! et pourtant la forme est tellement géniale qu'on ne peut que s'y laisser prendre et qu'on est obligé d'applaudir le maître... La dernière scène, avec le regard lointain et inquiet de Henry B. Walthall, se veut comme un plaidoyer pour la paix dans un monde en guerre... La paix ??? Mais laquelle ?.. Encore une fois rien n'est clair dans ce film : son racisme est trop appuyé pour qu'on y voie un appel à la paix...et pourtant c'est de toute évidence le message que le réalisateur a voulu faire passer... Quoi qu'il en soit Griffith avait ranimé les haines et était devenu, pour beaucoup, l'image même du sudiste raciste et intolérant...ce qui lui valut autant d'inimitiés que de soutiens... Qu'allait-il en faire ?.. Peut-être à cause de mon côté « bonne pomme » je décidai de lui accorder une chance de se rattraper, d'autant que son film suivant avait un nom pour le moins intrigant... J'ignorais alors que celui-ci serait, aujourd'hui, notre deuxième escale : une escale tout simplement magique !..
Dernière édition par Sudena le Mar 7 Aoû 2018 - 17:44, édité 1 fois
5 Re: Mon cinéma à-travers les temps Mer 30 Aoû 2017 - 16:10
Re: Mon cinéma à-travers les temps Mer 30 Aoû 2017 - 16:10
Sudena
Intolérance
D.W. Griffith; 1916
D.W. Griffith; 1916
L'immense succès de Naissance d'une Nation donne à Griffith une tranquillité financière certaine, lui assure une place au panthéon des arts, mais lui attire aussi l'ire bien mérité d'une partie non-négligeable du genre humain. Alors il décide de tout dépenser, de tout risquer, pour se racheter : de cette tentative de rédemption naît Intolérance, film dont la démesure a obligatoirement suscité railleries et quolibets (c'est incroyable comme, devant une œuvre titanesque, jalousies et mesquineries se réveillent...) mais dont le propos, la narration et la beauté sont, encore aujourd'hui, incroyables de puissance, à tel point qu'aucun, depuis, n'a eu son audace stylistique et encore moins narrative... Le propos de ce film est énoncé dans son titre : il s'agit de dénoncer l'intolérance quelle qu'elle soit, chose qui, dans un monde qui vit au rythme des sabotages de navires, des expéditions punitives dans le désert, et surtout des deux enfers que sont les batailles de Verdun et de la Somme, était non-seulement opportune mais salutaire...
Griffith, pour cela, utilise une narration tout à fait unique en entremêlant quatre histoires sans aucun lien entre elles, chacune se passant à une époque bien définie : leur seul lien est le message délivré et les émotions engendrées dont les changements sont symbolisés par l'image récurrente d'une femme (Lillian Gish) devant un berceau en perpétuel balancement. Ces quatre histoires n'ont ni la même importance ni la même ampleur ; celle se passant à Jérusalem au temps du Christ n'a, d'ailleurs, même pas de dramaturgie particulière : il s'agit d'une suite de « vignettes » mettant en valeur une partie de la Bible que le réalisateur a jugée « parlante » à tel ou tel moment du récit (la plus marquante étant certainement celle de la femme adultère). La deuxième histoire, elle aussi secondaire mais qui bénéficie d'une narration « complète » (un début, un climax, une fin) se déroule en France au moment de la terrible Nuit de la Saint Barthélémy et dénonce l'horreur des persécutions religieuses via une tragique histoire d'amour. Une autre histoire d'amour, mais, elle, dans l'un des deux récits principaux, de passe à l'époque contemporaine...et le moins que l'on puisse dire c'est que Griffith n'y va pas de main morte et porte un coup de poing impressionnant à son précédent film : ici, les dames de charité soi-disant philanthropes sont présentées comme des figures du mal absolu, et avec elles tous les codes de « vertu » religieuse qui empêchent les pauvres ouvriers de vivre heureux et les met à la merci des caprices des riches, lesquels sont dépeints comme aigris par leur argent...et leur vieil âge. La tragédie est là aussi inéluctable, portée tant par l'injustice et l'intolérance sociale (davantage que religieuse) que par les sentiments amoureux ou amicaux (quoique insuffisamment mis en valeur [certainement pour éviter « d'alourdir » le récit] le personnage de Miriam Cooper, confronté à des choix cornéliens, est l'un des plus intéressants jamais proposés et rompt tout manichéisme facile...). Mais davantage encore que cette histoire, l'autre récit principal, se déroulant à Babylone, est celui qui va le plus loin aussi bien dans les moyens techniques mis en œuvre (sur lesquels je reviendrai dans une minute) que dans son fond : c'est en-effet dans celui-ci que Griffith renie le plus violemment Naissance d'une Nation, avec une passion telle que je n'ai eu aucun doute sur sa sincérité... Dans cette partie il est de nouveau question de l'intolérance religieuse mais dans un sens très peu « biblique » vu que Babylone y est pratiquement sanctifiée et que le réalisateur ne se prive jamais d'y montrer l'harmonie qui y règne, harmonie tant religieuse, sociale...que raciale. De plus, outre la trahison orchestrée par des prêtres, cette histoire met en vedette une femme guerrière et indépendante (jouée par Constance Talmadge). Griffith, ainsi, ne se contente pas de dénoncer l'intolérance et le racisme d'une façon générale : il se montre incroyablement progressiste dans son propos en donnant, notons-le, dans les deux parties principales, les plus beaux et les plus forts rôles aux femmes !..
Que dire alors de la mise en scène ?.. Qu'elle est ébouriffante semble un euphémisme : jamais ou presque on n'a vu ça! Les techniques déjà éprouvées dans Naissance d'une Nation sont de nouveau utilisées mais elles sont bien davantage explorées et « variées ». Si Intolérance est moins long que son prédécesseur (d'environ vingt minutes), il est beaucoup plus dense et ne prend pratiquement jamais de repos, chaque histoire ayant sa propre technique particulière permettant de la reconnaître du premier coup : la couleur de pellicule pour la partie française, l'alternance des plans et des travellings dans la contemporaine, les fondus, panoramiques et caches divers pour la babylonienne. Une telle densité pourrait facilement donner le tournis, pourtant ce n'est jamais le cas car Griffith a le don de passer successivement d'une époque à une autre pour donner à chaque fois le temps de « digérer » une action ce qui est un moyen très efficace de maintenir l'attention en éveil (pour peu qu'on accepte le principe) : quel génie ! Et songeons, en plus, qu'il travaillait sans plan ni scénario : tout à l'instinct !.. Parmi les scènes les plus mémorables, il est impossible de ne pas évoquer la titanesque bataille sous les murs de Babylone avec une reconstitution de la ville grandeur-nature, une armée de figurants, et un suspense du feu de Dieu !.. Sa conclusion semble résumer l'ensemble du film : si, sur les quatre histoires, trois connaissent une fin tragique, l'espoir et l'appel à la paix semble hurlé à la face du monde avec une succession de tableaux en fondus divers qui, tous, montrent un monde idéalisé, sans chaînes, ni violence...ni intolérance. Extraordinaire film dont la complexité narrative en fit, hélas, un flop commercial, Intolérance est la première superproduction du cinéma et contribua largement à l'essor de l'industrie de cet art en Amérique. Depuis, nombreux l'ont imité, bien peu s'en sont seulement rapprochés...
Dernière édition par Sudena le Mar 7 Aoû 2018 - 17:45, édité 1 fois
6 Re: Mon cinéma à-travers les temps Jeu 31 Aoû 2017 - 17:19
Re: Mon cinéma à-travers les temps Jeu 31 Aoû 2017 - 17:19
Sudena
Ré-envolons-nous et regardons, soulagés, la fin de la Première Guerre Mondiale qui laissa l'Europe ravagée et profondément changée... Aux États-Unis, le système des nababs commença à entrevoir ses limites tandis que naissait progressivement un « star system » typiquement américain. Pourtant le cinéma, encore largement méprisé par les élites, s'apprêtait à vivre une révolution qui changea à-jamais sa face. C'est en Allemagne qu'elle eut lieu grâce à un film-manifeste (le terme n'est, ici, pas du tout galvaudé) qui sera notre prochaine étape...
7 Re: Mon cinéma à-travers les temps Ven 1 Sep 2017 - 2:10
Re: Mon cinéma à-travers les temps Ven 1 Sep 2017 - 2:10
Sudena
Le Cabinet du Docteur Caligari
Robert Wiene; 1919
Robert Wiene; 1919
La défaite militaire et ses conséquences engendrèrent un profond traumatisme et une non-moins profonde remise en question dans une Allemagne qui plus est secouée par des désordres internes sauvagement réprimés (comme en témoigne l'assassinat, dans leur prison, de Rosa Luxembourg et de Karl Liebcknecht, fondateurs de la Ligue spartakiste). Il n'est donc pas surprenant que des cinéastes aient, dans ce contexte, voulu retranscrire toutes les peurs et doutes qu'ils ressentaient, mais ils le firent d'une manière particulière en « transportant » dans le monde du cinéma un mouvement artistique déjà bien connu en peinture et en littérature : l'expressionnisme.
Regarder aujourd'hui Le Cabinet du Docteur Caligari, c'est se remettre vraiment à la croisée des chemins de l'histoire du cinéma : ce moment où il ne devient plus seulement fiction narrative mais également visuelle avec un irréalisme totalement revendiqué à tous les niveaux...exception faite des émotions mises en scène (ce qui est la limite de tout art « vivant »).
Son scénario est construit selon un principe le rendant douteux et « opaque » d'emblée : l'histoire est narrée par un fou se trouvant manifestement dans un asile d'aliénés : le spectateur n'a donc aucun moyen de savoir s'il doit y croire ou non. A-peine cette introduction est-elle achevée que nous arrivons dans ce qui va nous marquer de façon indélébile : les décors... Entièrement peints, tout en angles aigus, ne respectant aucune proportion ni aucun parallélisme, ils sont à l'image de l'histoire horrifique et tourmentée qui nous est narrée...et sont largement aidés par des maquillages du même acabit : sur-appuyés, violemment contrastés, ces-derniers font des personnages de véritables monstres dont le rôle est « défini » dès la première vision. A-partir de là on sait si on va aimer ou détester ce film... Cet esthétisme hors du commun laissera forcément des spectateurs « sur la touche » mais, si on y adhère, nous ne cesserons d'être éblouis par la beauté pure de ces décors, par les couleurs de pellicule, par les cartons même, calligraphiés dans le même « esprit »...et par l'histoire fascinante et terrifiante de ce docteur hypnotiseur qui utilisera un somnambule à des fins meurtrières...
Certainement le personnage le plus intrigant et le plus intéressant du film, Cesare le somnambule est interprété par un Conrad Veidt magistralement « félin », à la démarche « flottante » et au regard terrifiant...mais dont l'apparence maléfique va progressivement se nuancer jusqu'à en faire pratiquement un martyr : jouet de Caligari dont il exécute docilement les ordres comme un animal dressé, il ne réussira pourtant pas à tuer la jeune femme qu'il enlèvera et avec laquelle il fuira, tentant d'échapper à la fois à la foule qui le poursuit...et probablement à lui-même : il finira par abandonner la lutte et à se laisser mourir, privant du même coup son horrible maître d'un bouclier à sa propre folie...
Cette histoire, bien sûr, n'est à-priori qu'un délire...mais la fin du film laisse la porte ouverte à bien des interrogations et inquiétudes... En-effet, on y voit le narrateur enfermé dans un asile où se trouvent également les différents personnages de son histoire (Cesare, la jeune femme, Caligari...), mais cet asile est strictement le même que celui de ses fantasmes et on peut se demander si ceux-ci étaient un délire, un souvenir...ou une sorte de parabole extra-lucide. Cette impression désagréable se renforce encore lorsqu'on voit que le fameux « Caligari » est en fait le directeur de son asile. La dernière fermeture, qui s'attarde une seconde sur le visage du « bon docteur » dont le regard n'a rien de bienveillant, accentue ce sentiment de malaise. Et, d'ailleurs, où est Allan, l'ami du narrateur assassiné par Cesare sur ordre de Caligari dans son histoire ?.. Il est le seul personnage principal qu'on ne retrouve pas dans l'asile ; donc qui manipule qui ? qui est vraiment qui ?..
Passionnant, envoûtant, bonheur visuel terrifiant, Le Cabinet du Docteur Caligari a, en plus, offert au cinéma le droit d'être spirituel, irréaliste, terrifiant, voire prophétique : car, si nous faisons nôtre l'interprétation pessimiste et voyons dans le narrateur un Cassandre criant sa peur à la face du monde, le rapprochement est facile entre Caligari et un certain Adolf Hitler... Film extraordinaire dans tous les sens du terme, dont les influences sont encore largement visibles aujourd'hui, il a été le premier du mouvement expressionniste, lequel permit à l'Allemagne d'entrer avec fracas dans le firmament du cinéma mondial...et de lui donner plusieurs étoiles dont l'une va nous guider jusqu'à notre prochaine étape : je veux parler, bien sûr, de Freidrich Murnau...
Dernière édition par Sudena le Mar 7 Aoû 2018 - 17:46, édité 1 fois
8 Re: Mon cinéma à-travers les temps Sam 2 Sep 2017 - 20:17
Re: Mon cinéma à-travers les temps Sam 2 Sep 2017 - 20:17
Sudena
Nosferatu
Feridrich Murnau; 1922
Feridrich Murnau; 1922
L'image du vampire était, avouons-le, taillée sur mesure pour les cinéastes expressionnistes. Le vampire concentre pratiquement toutes les peurs et les fascinations du genre humain, or « peur » et « fascination » sont deux des ingrédients principaux du « tourment », clef et raison d'être de l'expressionnisme...
Freidrich Wilhem Murnau, cinéaste alors totalement inconnu, se met en tête de réaliser un film sue ce thème en adaptant le fameux Dracula de Bram Stoker. Mais ce génie en herbe n'entend pas retranscrire bêtement le roman en utilisant telles quelles les techniques et codes du cinéma de son temps. Non : il va aller beaucoup plus loin, explorer les thèmes cachés, choisir les chapitres sur lesquels insister ou au-contraire à éviter, glisser des messages quelque peu moqueurs voire sulfureux, et surtout montrer qu'on peut faire un film expressionniste en décors naturels !..
Car c'est bien le parti-pris esthétique le plus original de Nosferatu : aucun décor n'a été peint ou « artificiellement » reconstitué, les lieux de tournage ont été soigneusement sélectionnés mais il n'y a aucun « gadget » inutile à l'intrigue, destiné simplement à « embellir » le cadre (artifice qui sera la marque de fabrique des films d'horreur de la Universal dix ans plus tard). Les accessoires et maquillages participent de la même logique : l'horreur est suggérée par la terrifiante apparence de Max Schreck dans le rôle principal, la manière qu'a Murnau de filmer personnages, maisons abandonnées, vieux châteaux, brouillard ou ombres, la progression de l'intrigue, etc... mais rien n'est jamais « gratuit » et même les écritures démoniaques sur la lettre signant le départ de l'intrigue ont été faites par des membres de l'équipe de production (particulièrement Albin Grau) connaissant bien l'occultisme. Ce qui a pour conséquence de créer une ambiance des plus malsaines qui ne cesse d'aller crescendo à mesure que le film progresse et s'éloigne du roman qu'il respectait au début pratiquement à la lettre (hormis les noms des personnages pour des raisons de droits d'auteur [ce qui ne l'empêcha d'être condamné pour plagiat...]).
Le tournant se situe au moment où le comte quitte son château et prend un bateau le conduisant vers sa nouvelle contrée caché dans son cercueil. Dans le roman, ce voyage fait l'objet d'un chapitre passionnant mais relativement court, or Murnau le transforme en basculement de l'intrigue : ce moment où la Mort personnifiée a été libérée et arrive sous la forme d'une épidémie de peste devant des personnages dont le réalisateur se délecte de nous montrer l'impuissance voire le côté carrément falot. Orlok devient ainsi symbole de toutes les formes de Thanatos, et il ne pourra être détruit qu'au prix d'un sacrifice humain, sacrifice qui permettra de sauver Knock, le complice du comte, de la vindicte populaire. Knock est d'ailleurs un personnage des plus intéressant : envoûté par Orlok auquel il doit obéir, il est ensuite enfermé à-cause de sa bizarrerie, puis devra fuir la foule le rendant responsable de la peste et décidée à le lyncher. Il est interprété par Alexander Granach qui, ironie du destin, devra quelques années plus tard fuir l'Allemagne pour échapper aux nazis...
Dans ce film passionnant qui, malgré ses décors naturels, demeure totalement expressionniste, Murnau démontre une classe étincelante : sa façon de saisir les angles, d'utiliser les fondus et les ombres, d'établir un véritable code-couleur pour signifier très simplement le moment de la journée, est simplement géniale, comme l'est son talent de conteur qui transforme une bonne histoire en un véritable cauchemar métaphysique (en symbole cette inoubliable scène de la montée de l'escalier où nous ne voyons que l'ombre démesurée de Max Schreck se détachant sur le mur). Nosferatu, qui a enchanté les surréalistes, a imposé Freidrich Murnau comme un génie du cinéma et LE grand maître de l'expressionnisme allemand : il ne devait pas tarder à confirmer ce statut...
Dernière édition par Sudena le Mar 7 Aoû 2018 - 17:47, édité 1 fois
9 Re: Mon cinéma à-travers les temps Lun 4 Sep 2017 - 18:59
Re: Mon cinéma à-travers les temps Lun 4 Sep 2017 - 18:59
Sudena
Quittons l'Allemagne et envolons-nous vers un pays dont le destin bascule définitivement en cette année 1922 : l'Union Soviétique. La Guerre Civile russe s'y achève sur la victoire l'Armée Rouge et le pays bascule brusquement du Moyen-Âge au communisme. Hélas, la mort de Lénine et les combines du gangster Staline transforment cet espoir en un régime totalitaire qui ne tardera pas à devenir sanguinaire... Pour autant, le formidable élan de renouveau initié dès la Révolution de 1917 a amené des changements profonds dont le premier fut l'alphabétisation massive du pays. Avant la guerre, en-effet, l'immense majorité de la population ne savait ni lire ni écrire, et les bolcheviques se sont, pour soutenir leur cause, mués en véritables missionnaires et apporté la culture au fin fond des campagnes... Une école critique et linguistique y devait non-pas naître (elle a commencé en 1914) mais s'y affirmer : le formalisme. Et le cinéma n'est pas en reste avec une génération de réalisateurs souvent engagés qui assura au pays un rayonnement mondial. Deux figures s'y détachent particulièrement : Dziga Vertov et surtout Sergueï Eisenstein...
10 Re: Mon cinéma à-travers les temps Mar 5 Sep 2017 - 18:46
Re: Mon cinéma à-travers les temps Mar 5 Sep 2017 - 18:46
Sudena
Le Cuirassé Potemkine
Sergueï Eisenstein; 1925
Sergueï Eisenstein; 1925
Au-delà des clichés, travestissements, trahisons et légendes diverses, le communisme est d'abord un idéal. Un idéal d'égalité, de vivre ensemble et de partage qui n'est pas sans rappeler certains messages chrétiens (« Aimez-vous les uns les autres », le partage du pain...) mais qui, de par précisément sa portée universelle et sa foi exclusive en l'homme, s'affranchit de tout dogme religieux au point de devenir l'ennemi naturel des Églises.
L'idéal communiste, Sergueï Eisenstein y croyait. Profondément. Viscéralement... Il le mit donc en scène dans ses films, sans jamais le trahir (j'y reviendrai dans quelques temps). L'Histoire récente de la Russie lui fournissait du bon matériau pour cela et c'est tout naturellement qu'il l'utilisa en réalisant plusieurs films mettant en scène _ pour résumer grossièrement _ un peuple uni affrontant l'oppresseur tsariste. Mais Eisenstein n'était pas seulement un communiste « bêlant » à qui on aurait donné une caméra, tout au contraire : c'était un homme remarquablement intelligent et un cinéaste qui avait, le premier, compris le pouvoir politique de cet art et la foi qu'un film peut donner en une cause quand le réalisateur met son cerveau au service de son idéal. Vous l'auriez compris, Sergueï Eisenstein avait comme maître et exemple monsieur D.W. Griffith : il fut son meilleur disciple. Et Le Cuirassé Potemkine est, à n'en pas douter, l'œuvre dans laquelle il fit le plus étalage de son étincelant talent...
L'action se passe pendant la guerre russo-japonaise, plus précisément à la fin de celle-ci. Nous n'allons pas trop nous y attarder mais simplement rappeler qu'elle ne dura qu'une année et qu'elle vit la défaite complète d'une Russie engoncée dans son passé et ses certitudes de puissance heurtant le simple bon sens face à des japonais infiniment plus « novateurs » dans leur approche stratégique qui permirent pour la première fois à l'Asie de vaincre une grande puissance militaire européenne. Le 27 mai 1905, à la bataille de Tsushima, la flotte russe fut proprement humiliée et envoyée par le fond : cette bataille sonna le glas de ses derniers espoirs...et pourtant la guerre devait durer encore plusieurs mois. Inutilement... Mais, pour Eisenstein, la défaite matérielle n'était que la conséquence d'une défaite infiniment plus grave en soi: la défaite morale !.. C'est pourquoi il choisit, pour son film, de montrer un événement très particulier de cette guerre : la mutinerie du Potemkine.
De là il va faire montre de toute sa classe. Son sens du montage va lui permettre de réaliser une prouesse qui marque encore aujourd'hui de façon indélébile ceux qui voient son film : l'extension du temps. Je m'explique : lorsque nous sommes témoins d'une scène particulièrement marquante ou que nous attendons fébrilement que quelque-chose se passe (quelle que soit la « chose ») le temps semble comme suspendu... Or c'est précisément ce qui se passe dans ce film...mais de façon réelle : Eisenstein sort la durée de la réalité en multipliant les plans et points de vue divers pour rentrer au cœur de l'émotion. Le suspense en est augmenté mais surtout, et c'est le plus important, les sentiments sont décuplés... Trois exemples des plus flagrants : d'abord les soldats hésitant à tirer sur leurs camarades malgré l'ordre des commandants, puis se se joignant à la mutinerie ; ensuite et surtout la fameuse séquence de l'escalier d'Odessa, particulièrement le landau en détresse descendant les marches après que la mère du bébé ait été tuée, sous le regard horrifié des autres protagonistes ; enfin l'attente nocturne, encore plus longue, avec la question décisive qui nous noue la gorge de façon insupportable : « va-ton nous tirer dessus ou nous laisser passer ?.. ».
Le Cuirassé Potemkine ne se résume pas à cette seule technique : le faciès des personnages, la façon d'utiliser les gros plans, la plongée ou la contre-plongée pour définir le rôle de chacun, la musique (composée pour partie par Dimitri Chostakovitch), la photographie, en font une œuvre éblouissante du simple point de vue cinématographique (dans le sens technique du terme). La scène de l'escalier d'Odessa est extrêmement « parlante » dans ce sens : les visages de civils victimes de la répression sont pris en plongée qui montre leurs visages « lumineux », tandis que les soldats tsaristes sont pris de dos, dans l'ombre, tels des démons aveugles et inhumains. Plus subtil encore : plus ils avancent plus ils tirent vers le bas, visant des infirmes et des bébés : leurs tirs définissent ainsi leur niveau moral...
Mais le plus de ce film est, selon moi, l'absence de héros individuel : le personnage semblant prendre ce rôle, celui qui, le premier, appelle à la mutinerie, est aussi le premier à mourir, rendant le soulèvement contre l'oppression véritablement collectif et pas dépendant d'un messie quelconque. L'œuvre est, de ce fait, véritablement communiste et sa scène la plus symbolique, la plus jouissive et la plus émouvante se situe au beau milieu : devant le cadavre de ce marin martyr, la population d'Odessa se rend compte de l'injustice et du désespoir qui ont poussé cet équipage à se mutiner et elle décide de s'associer à lui, à se rebeller elle-aussi contre l'oppression tsariste (tout en refusant l'antisémitisme et la tactique du bouc-émissaire...). Je défie quiconque de n'avoir pas frissonné en voyant ces quais envahis par cette foule généreuse, ces femmes de tout âge et de toutes conditions s'improvisant oratrices, cette ville en fait s'éveiller à l'espoir en même temps que le soleil se lève sur elle, en en chassant la brume !..
Inoubliable film, Le Cuirassé Potemkine est le meilleur porte-parole de l'idéal qu'il défend : le communisme, c'est ÇA ! Longtemps interdit en Amérique, il n'en a pas moins été considéré comme l'un des plus grands chefs d'œuvre du cinéma muet et il reste un modèle de film, inoubliable et incontournable : le fleuron du cinéma soviétique et certainement le meilleur Eisenstein (c'est dire...).
Dernière édition par Sudena le Mar 7 Aoû 2018 - 17:47, édité 1 fois
11 Re: Mon cinéma à-travers les temps Jeu 7 Sep 2017 - 3:39
Re: Mon cinéma à-travers les temps Jeu 7 Sep 2017 - 3:39
Sudena
Ré-embarquons-nous et revenons en Allemagne, où le cinéma multiplie les innovations et les offre au monde comme on distribuerait de l'or en barres. L'expressionnisme est à l'agonie : son rayonnement mondial est en train de l'étouffer et des réalisateurs comme Fritz Lang refusent _ contre toute honnêteté _ de se revendiquer expressionnistes afin que le genre n'étouffe pas leur nom... Assumant, lui, parfaitement son appartenance à ce mouvement, Freidrich Murnau est pourtant le premier à innover et à proposer des histoires sortant de l'onirisme et du cauchemar fantastique propre à l'expressionnisme...tout en utilisant ses techniques de plans, d'espace et de lumière ce qui va permettre « d'ouvrir » le genre au cinéma en général et lui assurer un rayonnement au-delà de sa mort programmée à brève échéance... En 1925, Le Dernier des Hommes illustre cette volonté et inaugure le « Kammerspielfilm » (« film de chambre » en français) : genre réaliste réalisé avec des équipes de tournage réduites et narrant des histories « ordinaires » dans un cadre qui l'est tout autant (en apparence tout du moins). Murnau est au sommet de sa gloire : inventeur, touche à tout, esthète et intellectuel à la culture générale inépuisable, il met le monde du cinéma à ses pieds et l'Amérique lui fait les yeux doux... Mais cet artiste-né n'a pas l'intention d'abandonner comme ça ni son pays ni ses premières amours, et, en 1926, il va non-seulement montrer qu'il est parfaitement capable de gérer également un tournage avec des moyens financier énormes, mais aussi offrir à l'expressionnisme un ultime chef d'œuvre avant de traverser l'Atlantique et de laisser le genre mourir sereinement de sa belle mort (le dernier film comprenant des scènes totalement expressionnistes sera le très impressionnant Loulou de Georg Wilhem Pabst [avec Louise Brooks dans le rôle principal] en 1929)...
12 Re: Mon cinéma à-travers les temps Ven 8 Sep 2017 - 19:35
Re: Mon cinéma à-travers les temps Ven 8 Sep 2017 - 19:35
Sudena
Faust
Freidrich Murnau; 1926
Freidrich Murnau; 1926
La jeunesse éternelle, l'amour impossible, la damnation, la lutte entre le Bien et le Mal : on pourrait s'étonner que le mythe de Faust ait tant tardé à être repris par les expressionnistes, d'autant plus qu'il est, lui-aussi, totalement « allemand »... Ne nous en plaignons pas : l'attente a été récompensée par le plus éblouissant, le plus impressionnant, le plus émouvant et probablement le plus cynique film expressionniste qui ait jamais été...
D'entrée de jeu le ton est donné, qui ne se démentira jamais : Murnau disposait d'énormes moyens matériels et financiers pour réaliser son film et il n'avait nullement l'intention de se priver de les montrer et de les exploiter. Aussi nous sommes embarqués dans un tourbillon visuel comprenant des fondus divers et variés, des surimpressions, des angles impossibles, des jeux de lumières en-veux-tu-en-voilà, des décors magnifiques et tourmentés comme pas autorisé, sans oublier le faciès de Méphisto (Emil Jannings) aussi diabolique que comique...et ainsi curieusement attachant...
Ce point me permet de développer une caractéristique très particulière de ce film, qui est sans-doute celle qui m'a le plus marqué : l'ambiguïté de sa morale... On sait tous que, dans le mythe de Faust, l'amour est censé sauver « in-extremis » les deux personnages principaux de la damnation et donc assurer la victoire de Dieu sur le Diable, mais cette conclusion très chrétienne demeure obscure, car, quand-même, Méphisto est bien parvenu à séduire Faust et à l'amener sur la voie de la damnation... Une trentaine d'années après ce film, dans La Comtesse aux Pieds Nus, le personnage d'Humphrey Bogart résume cette pensée en une phrase lapidaire : « On dit que c'est Dieu qui a gagné...moi je pense qu'il y a eu match nul. ». Or, dans Faust, Murnau ne semble pas seulement d'accord avec cette phrase : il va plus loin dans l'ambiguïté et n'hésite pas à montrer l'environnement social des personnages, avec un cynisme magistral !.. Certes, il ne travestit pas complètement le mythe et montre la fin rédemptrice connue...mais cette conclusion est trop brève, trop « convenue » pour qu'on y croie réellement... Rien, en-effet, dans le propos du film, ne nous y amène de façon logique : elle arrive comme un cheveu sur la soupe et fait donc bigrement penser à une pirouette de convenance qui ne doit en aucune façon faire oublier ce qui l'a précédée (d'autant plus que Murnau montre plusieurs fois dans son film qu'il sait prendre son temps et que la longueur ne lui fait pas peur) !.. La clef de cet extraordinaire coup d'audace est peut-être la défiance qu'éprouvait le réalisateur vis à vis de la morale chrétienne, eu égard à son homosexualité (notoire, même à cette époque)...
Penchons-nous-y... Les décors, pour commencer, n'ont rien de « gratuit » dans leur splendeur expressionniste : les angles aigus de ces ruelles toutes en verticalité semblent symboliser les abîmes de l'âme humaine confrontée à ses certitudes...et conséquemment capable de descendre aux tréfonds de son horreur ordinaire ; les scènes échappant à ce tourment sont d'une part le voyage « d'essai » que fait faire Méphisto à Faust pour l'encourager aux plaisirs, d'autre part ces moments de détente dans le jardin où Gretchen (bouleversante Camilla Horn) à la fois s'éveille à l'amour et joue avec les enfants, symboles même de l'innocence.
Gretchen est, d'ailleurs, le seul personnage vraiment angélique du film : pure et sincère dans son amour pour Faust, sœur, nièce et fille aimante, amie des enfants, elle est d'autant plus aimable que TOUS les autres sont montrés dans l'évidence de leur odieuse médiocrité... Faust, pour commencer, est très vite montré comme au moins avide...puis rapidement lâche, vindicatif, hypocrite et intellectuellement paresseux. Est-ce le seul ? Que nenni ! le « bon peuple » fidèle au Seigneur demande dans un premier des miracles...puis est prêt à lapider celui qui le lui donne sous prétexte de son pacte avec le Démon (avec, notons-le, un silence assourdissant dudit Seigneur...) ; ce même « bon peuple » va, à la fin, refuser toute aide à la pauvre Gretchen, rire de son malheur...et la condamner au bûcher en la traitant de monstre lorsque son enfant mourra de froid !.. Que dire des autres ?.. Valentin, le « gentil frère » tué par Faust et Méphisto en essayant de défendre l'honneur de sa sœur (référence explicite au « Dom Juan » de Molière) aura la force de rester en vie assez longtemps...pour la renier au su de tous et exiger un châtiment !.. Encore plus hypocrite, la tante Marthe, alchimiste et un peu sorcière à ses heures, sera docilement séduite par Méphisto...avant de refuser toute compassion à sa nièce lorsqu'elle sera condamnée au pilori... La malheureuse Gretchen, elle, essaiera de survivre et surtout de faire survivre son enfant, sa misère la rendant folle au point de le livrer à la neige en croyant le mettre dans un berceau. L'injustice de son sort l'amène à côtoyer, je pense de façon tout à fait volontaire et délibérée de la part de Murnau, autant la Fantine des Misérables de Hugo que La Petite Fille aux allumettes d'Andersen...
Et Méphisto dans tout ça ?.. Eh bien, Méphisto, aussi diabolique et manipulateur soit-il, ne se ment pas à lui-même, a une « fraîcheur comique » certaine...et respecte sa parole... Il est de ce fait, aussi paradoxal que cela puisse paraître, un personnage presque sympathique, en tout cas infiniment plus que le héros qui ne lui échappe, nous l'avons vu, que par une pirouette scénaristique à laquelle on a, décidément, beaucoup de mal à croire...
Aussi dense dans son fond qu'éblouissant dans sa forme, Faust, dernier film allemand de Freidrich Murnau, ressemble à un bouquet final chatoyant que le réalisateur aurait offert à l'expressionnisme, et il est probablement celui qui le symbolise le plus. Mais si Murnau devait par la suite partir pour l'Amérique, il ne laissa en Allemagne ni son âme, ni son génie...
13 Re: Mon cinéma à-travers les temps Sam 9 Sep 2017 - 21:00
Re: Mon cinéma à-travers les temps Sam 9 Sep 2017 - 21:00
Sunil
Administrateur
C'est un livre que tu devrais écrire !
Je prendrai le temps de lire quand mon travail m'en laissera un peu.
Je prendrai le temps de lire quand mon travail m'en laissera un peu.
14 Re: Mon cinéma à-travers les temps Sam 9 Sep 2017 - 23:07
Re: Mon cinéma à-travers les temps Sam 9 Sep 2017 - 23:07
Sudena
Ben, en fait, c'est le but...
Merci de me le dire en tout cas...
Merci de me le dire en tout cas...
15 Re: Mon cinéma à-travers les temps Dim 10 Sep 2017 - 21:53
Re: Mon cinéma à-travers les temps Dim 10 Sep 2017 - 21:53
Sunil
Administrateur
Sudena a écrit:Ben, en fait, c'est le but...
Génial
16 Re: Mon cinéma à-travers les temps Lun 11 Sep 2017 - 23:37
Re: Mon cinéma à-travers les temps Lun 11 Sep 2017 - 23:37
Sudena
Arrêtons-nous un instant, car nous sommes, maintenant, en 1926. Or 1926 est une date tout à fait spéciale pour le cinéma et ce pour deux raisons, toutes deux américaines... La première est dans les studios de la Warner et s'appelle Le Chanteur de jazz : le puissant studio a décidé de se lancer dans une aventure nouvelle : la parlant. Pour l'heure il ne s'agit que d'un projet, mais quand il verra le jour un an plus tard la déferlante sera à la hauteur de l'audace...
Mais surtout, 1926 est idéale pour parler d'un phénomène que nous avions juste survolé jusqu'alors : le star-system. Qu'est-ce précisément ? Tout simplement l'élévation au rang de dieux vivants d'acteurs définis par un rôle- « type » qu'ils symbolisaient mieux que tous les autres... En pionnier il y avait un français, sorte de clown blanc sans méchanceté : Max Linder. Hélas, peut-être arrivé un peu trop tôt, il ne fut jamais reconnu à sa juste valeur, mais il avait inspiré celui qui fut LE symbole du comique muet : Charlie Chaplin, qui le premier se donna un personnage dont il ne varia jamais (ou si peu) : Charlot, à-savoir le vagabond gaffeur. Un autre comique tout aussi important mais bien plus pince sans rire, au regard de petit garçon perdu : Buster Keaton dont on apprécie autant aujourd'hui la variété et la maîtrise des gags basés sur le coup de théâtre permanent... Mais les comiques ne furent pas les seuls à être glorifiés et déifiés : Mary Pickford symbolisa la femme-enfant au point d'être surnommée « La petite fiancée de l'Amérique » ; Douglas Fairbanks était le justicier gentleman, élégant et « classieux » ; Gloria Swanson, elle, était la « vamp » sulfureuse, la femme fatale au sex-appeal irrésistible ; mais l'acteur qui m'a, personnellement, le plus séduit...est celui sur qui il est de très bon ton de casser du sucre aujourd'hui : Rudolph Valentino.
Né en Italie, cherchant un peu partout sa voie sans la trouver et finalement émigrant en Amérique où ses talents de danseur et sa belle gueule le firent remarquer par des réalisateurs qui lui donnèrent quelques rôles dans lesquels il réussit plutôt bien avant qu'un film ne lance définitivement et sa carrière et sa légende, Rudolph Valentino est, en soi, un symbole du rêve américain. Sa popularité naquit d'un film qui devait définir à-jamais et son image et son type de rôle : Le Cheik. Daté de 1921, ce film est une bluette assez insignifiante en soi, qui avait néanmoins le mérite de défier quelque peu les lois anti-métissage racial, mais sa force vint du fait que Valentino, alors inconnu du grand public, s'y imposa un peu à la surprise générale (le studio ayant, à la base, misé son succès sur la petite réputation de l'actrice principale, Agnes Ayres). Il devint alors l'archétype du « latin-lover » : charme exotique, sex-appeal « animal », grande silhouette aux cheveux gominés très bruns, souvent assez outrageusement maquillé, il fut conséquemment détesté par une partie du public masculin qui l'accusa de féminiser l'image du « mâle ». Ce sont ces mêmes accusations que l'on retrouve aujourd'hui, en plus d'une jalousie latente vis à vis de ce parvenu qui séduisait comme il respirait uniquement grâce à sa belle gueule (je caricature volontairement)... Mais a-t-on pris la peine de regarder totalement un seul de ses films ?.. s'est-on véritablement posé la question de ce que valait l'acteur derrière le maquillage ?.. Indépendamment de ça, l'honnêteté oblige à reconnaître que l'accusation consistant à dire qu'il jouait toujours le même personnage...s'appliquerait tout autant _ sinon plus _ à un Chaplin, un Keaton, une Pickford, un Fairbanks ou une Swanson...
Examinons ça de plus près : ce qui m'a frappé lorsque j'ai vu pour la première fois Valentino fut précisément...la sobriété de son jeu. Le corps est effectivement très impressionnant et en « dégage » énormément mais les mouvements et le faciès sont très réduits (sans être pour autant « figés ») : Valentino, qui pourtant avait commencé sa carrière d'artiste comme danseur scénique, avait instinctivement compris que le jeu-cinéma n'est pas le jeu-théâtre et que surjouer n'apporte rien de plus au film... C'est probablement cette modestie qui explique son succès, car, quand-même !, n'allez pas me dire qu'il était le seul beau mec de Hollywood à cette époque ! et qu'être beau suffit pour être une star !.. Valentino tournera par la suite dans des dizaines de films où sa seule présence suffisait à assurer le succès commercial. Si aucun n'est un chef d'œuvre du septième art, ses performances sont par plus impressionnantes lorsque ses rôles sont un peu plus « denses » que d'habitude. Je veux parler particulièrement d'Arènes Sanglantes où il joue un matador fuyant dans sa gloire et pris au piège d'une séductrice vampirisante ; ou encore plus dans L'Aigle Noir où il interprète un officier russe devenu rebelle par honneur qui voit ses convictions vaciller au moment où il rencontre l'amour... Danseur voire chanteur à ses heures, il était également apprécié par ceux qui le côtoyaient régulièrement (dont Chaplin), lesquels l'ont dépeint comme un gentleman très ouvert aux cultures du monde (ce n'est pas pour rien qu'il a beaucoup défendu son personnage du cheik...). En 1926, il reprit le rôle qui l'avait fait connaître, jouant pour l'occasion à la fois le père et le fils. Le Fils du Cheik, qui eut un succès public phénoménal, est principalement connu pour comporter LA scène de Valentino par-excellence : celle de la séduction « animale » avec Vilma Banky dans le rôle féminin principal. Le 23 août de la même année, il mourut brutalement d'une septicémie consécutive à un ulcère mal soigné. Il avait 31 ans... Son enterrement donna lieu à des scènes d'hystérie mondiales et douze de ses admiratrices se suicidèrent pour le suivre dans l'Au-Delà.
Rudolph Valentino, image et icône immortelle du cinéma muet, a plus et mieux que tous les autres incarné l'image de la star des Années Folles. Il demeure un acteur exemplaire au charisme total qui a plus que largement mérité cette reconnaissance que certains, aujourd'hui, essaient de lui ôter (comme c'est facile d'attaquer les morts !..). Mais il est temps maintenant d'arrêter le survol car nous arrivons à notre prochaine escale. Celle-ci est américaine et une vieille connaissance nous y attend : notre cher ami Freidrich Murnau...
Mais surtout, 1926 est idéale pour parler d'un phénomène que nous avions juste survolé jusqu'alors : le star-system. Qu'est-ce précisément ? Tout simplement l'élévation au rang de dieux vivants d'acteurs définis par un rôle- « type » qu'ils symbolisaient mieux que tous les autres... En pionnier il y avait un français, sorte de clown blanc sans méchanceté : Max Linder. Hélas, peut-être arrivé un peu trop tôt, il ne fut jamais reconnu à sa juste valeur, mais il avait inspiré celui qui fut LE symbole du comique muet : Charlie Chaplin, qui le premier se donna un personnage dont il ne varia jamais (ou si peu) : Charlot, à-savoir le vagabond gaffeur. Un autre comique tout aussi important mais bien plus pince sans rire, au regard de petit garçon perdu : Buster Keaton dont on apprécie autant aujourd'hui la variété et la maîtrise des gags basés sur le coup de théâtre permanent... Mais les comiques ne furent pas les seuls à être glorifiés et déifiés : Mary Pickford symbolisa la femme-enfant au point d'être surnommée « La petite fiancée de l'Amérique » ; Douglas Fairbanks était le justicier gentleman, élégant et « classieux » ; Gloria Swanson, elle, était la « vamp » sulfureuse, la femme fatale au sex-appeal irrésistible ; mais l'acteur qui m'a, personnellement, le plus séduit...est celui sur qui il est de très bon ton de casser du sucre aujourd'hui : Rudolph Valentino.
Né en Italie, cherchant un peu partout sa voie sans la trouver et finalement émigrant en Amérique où ses talents de danseur et sa belle gueule le firent remarquer par des réalisateurs qui lui donnèrent quelques rôles dans lesquels il réussit plutôt bien avant qu'un film ne lance définitivement et sa carrière et sa légende, Rudolph Valentino est, en soi, un symbole du rêve américain. Sa popularité naquit d'un film qui devait définir à-jamais et son image et son type de rôle : Le Cheik. Daté de 1921, ce film est une bluette assez insignifiante en soi, qui avait néanmoins le mérite de défier quelque peu les lois anti-métissage racial, mais sa force vint du fait que Valentino, alors inconnu du grand public, s'y imposa un peu à la surprise générale (le studio ayant, à la base, misé son succès sur la petite réputation de l'actrice principale, Agnes Ayres). Il devint alors l'archétype du « latin-lover » : charme exotique, sex-appeal « animal », grande silhouette aux cheveux gominés très bruns, souvent assez outrageusement maquillé, il fut conséquemment détesté par une partie du public masculin qui l'accusa de féminiser l'image du « mâle ». Ce sont ces mêmes accusations que l'on retrouve aujourd'hui, en plus d'une jalousie latente vis à vis de ce parvenu qui séduisait comme il respirait uniquement grâce à sa belle gueule (je caricature volontairement)... Mais a-t-on pris la peine de regarder totalement un seul de ses films ?.. s'est-on véritablement posé la question de ce que valait l'acteur derrière le maquillage ?.. Indépendamment de ça, l'honnêteté oblige à reconnaître que l'accusation consistant à dire qu'il jouait toujours le même personnage...s'appliquerait tout autant _ sinon plus _ à un Chaplin, un Keaton, une Pickford, un Fairbanks ou une Swanson...
Examinons ça de plus près : ce qui m'a frappé lorsque j'ai vu pour la première fois Valentino fut précisément...la sobriété de son jeu. Le corps est effectivement très impressionnant et en « dégage » énormément mais les mouvements et le faciès sont très réduits (sans être pour autant « figés ») : Valentino, qui pourtant avait commencé sa carrière d'artiste comme danseur scénique, avait instinctivement compris que le jeu-cinéma n'est pas le jeu-théâtre et que surjouer n'apporte rien de plus au film... C'est probablement cette modestie qui explique son succès, car, quand-même !, n'allez pas me dire qu'il était le seul beau mec de Hollywood à cette époque ! et qu'être beau suffit pour être une star !.. Valentino tournera par la suite dans des dizaines de films où sa seule présence suffisait à assurer le succès commercial. Si aucun n'est un chef d'œuvre du septième art, ses performances sont par plus impressionnantes lorsque ses rôles sont un peu plus « denses » que d'habitude. Je veux parler particulièrement d'Arènes Sanglantes où il joue un matador fuyant dans sa gloire et pris au piège d'une séductrice vampirisante ; ou encore plus dans L'Aigle Noir où il interprète un officier russe devenu rebelle par honneur qui voit ses convictions vaciller au moment où il rencontre l'amour... Danseur voire chanteur à ses heures, il était également apprécié par ceux qui le côtoyaient régulièrement (dont Chaplin), lesquels l'ont dépeint comme un gentleman très ouvert aux cultures du monde (ce n'est pas pour rien qu'il a beaucoup défendu son personnage du cheik...). En 1926, il reprit le rôle qui l'avait fait connaître, jouant pour l'occasion à la fois le père et le fils. Le Fils du Cheik, qui eut un succès public phénoménal, est principalement connu pour comporter LA scène de Valentino par-excellence : celle de la séduction « animale » avec Vilma Banky dans le rôle féminin principal. Le 23 août de la même année, il mourut brutalement d'une septicémie consécutive à un ulcère mal soigné. Il avait 31 ans... Son enterrement donna lieu à des scènes d'hystérie mondiales et douze de ses admiratrices se suicidèrent pour le suivre dans l'Au-Delà.
Rudolph Valentino, image et icône immortelle du cinéma muet, a plus et mieux que tous les autres incarné l'image de la star des Années Folles. Il demeure un acteur exemplaire au charisme total qui a plus que largement mérité cette reconnaissance que certains, aujourd'hui, essaient de lui ôter (comme c'est facile d'attaquer les morts !..). Mais il est temps maintenant d'arrêter le survol car nous arrivons à notre prochaine escale. Celle-ci est américaine et une vieille connaissance nous y attend : notre cher ami Freidrich Murnau...
17 Re: Mon cinéma à-travers les temps Lun 18 Sep 2017 - 14:57
Re: Mon cinéma à-travers les temps Lun 18 Sep 2017 - 14:57
Sudena
L'Aurore
Freidrich Murnau; 1927
Freidrich Murnau; 1927
Lorsque la Fox engage Murnau et lui donne tous les moyens pour faire le film qu'il a envie de faire, elle ne se doute probablement pas de ce que ce génie tout juste débarqué d'Allemagne s'apprête à offrir au cinéma... Autant le dire tout de suite : L'Aurore fait partie de ces films immortels qui seront, probablement, reconnus comme des chefs d'œuvres au-delà des siècles et des cultures. « Le plus beau film du monde » a dit Truffaut. Ça se défend. Le plus parfait du cinéma muet, certainement...
Cette pluie d'éloges pourrait pourtant sembler surprenante, voire incongrue, au vu du synopsis. Il s'agit en-effet d'un mélodrame totalement classique et prévisible avec un paysan « happé », durant l'été, par une vamp venue de la ville, laquelle le persuadera de tuer sa femme et de partir avec elle. Cependant, au moment d'accomplir le geste fatal, il reculera, puis tentera de se faire pardonner. Les deux époux vont, de là, redécouvrir leurs sentiments : leur amour en sortira sublimé et immortalisé...
Mais comment un tel scénario a-t-il pu donner seulement un bon film ?!. peut-on se demander, estomaqué. Et la réponse est simple : L'Aurore a été réalisée par Freidrich Murnau. Le génial réalisateur va donc faire, ici, ce qu'il sait faire de mieux : sublimer le scénario en le mettant en images. C'est le lot de tout réalisateur qui se respecte, me direz-vous. Oui... Mais c'est Murnau. C'est à dire également un historien d'art, un intellectuel invétéré, un esthète forcené, et surtout un expressionniste.
Car là est bien la caractéristique la plus frappante de L'Aurore : s'il ne s'agit pas d'un film expressionniste, elle n'a pu être réalisée que par un expressionniste !.. Les rêves éveillés mis en images par des surimpressions permanentes de pellicules, l'utilisation des lumières et des lieux pour suggérer tantôt l'amour tantôt la mort (sur le modèle classique mais imparable de la clarté opposée à l'obscurité), les angles de prise de vue, travellings et panoramiques divers ayant chacun un sens bien particulier à un moment M (aucun n'est jamais « gratuit »), la puissance symbolique des objets, le jeu des acteurs : tout, lorsqu'on examine chaque détail à la loupe, respire l'expressionnisme le plus complet et le plus pur !.. Murnau va même encore plus loin dans sa manière de diriger les acteurs : renonçant à la tradition théâtrale qui voudrait qu'il leur dise comment jouer, il se contente de leur indiquer ce qu'ils doivent ressentir, ce qui a complètement décuplé leurs émotions et la sincérité rendue à l'écran, principalement bien sûr pour le couple principal, George O'Brien et Janet Gaynor, dont les personnages _ chose absolument remarquable _ ne portent aucun nom. Murnau savait bien, en réalisant son film, qu'il offrait une histoire intemporelle et universelle : l'amour, la tentation, la séduction, la passion, les rires et les larmes, les doutes et les jeux, sont, après tout, le lot de chaque être humain, par-delà les mers et les âges...
Cependant, tout ça ne suffit pas à assurer l'immortalité d'une œuvre et on peut même douter de l'efficacité du procédé consistant à réaliser une histoire réaliste et universelle avec des moyens expressionnistes... Et c'est peut-être là que Murnau va le plus se transcender et faire le plus étalage de son génie. D'abord en reprenant une idée qu'il avait déjà employée dans Nosferatu : utiliser des décors sinon naturels, du moins naturalistes. L'expressionnisme n'est, ainsi, que dans les mouvements et techniques de caméra : il n'est pas immédiatement perceptible et un spectateur non-averti et/ou rétif à ce mouvement artistique a de bonnes chances de ne pas le remarquer. Une deuxième conséquence est que cela « fluidifie » notablement la narration, permettant ainsi de se recentrer sur les émotions directes des personnages sans se rendre compte (ou sinon rétrospectivement) de celles qui nous sont communiquées de façon indirecte grâce aux différentes techniques précitées. De cette façon, le film n'est jamais narcissique : le style n'attire pas l'attention sur le style ni ne « double » le discours narratif. Il y aurait pourtant eu de quoi tant la photographie est merveilleuse...et est si souvent évoquée aujourd'hui : quand on parle de L'Aurore, en-effet, on parle d'abord de sa beauté pure qui en a fait un modèle pour tous les réalisateurs « esthètes » (de John Ford à Michelangelo Antonioni en passant par Orson Welles). Cette beauté est d'autant plus remarquable qu'elle s'affranchit du manichéisme... Profondément lumineux, ce film ne part pas sur une idiote opposition entre la « bonne » campagne et la « méchante » ville : si la vamp destructrice vient bien de la ville, les deux tourtereaux vont précisément « s'abreuver » de la ville pour reconstruire leur couple et y croiseront nombre de personnages sympathiques et bienveillants (cette partie est, d'ailleurs, la plus agréable en soi car elle permet de vraiment « respirer »...et nous offre plusieurs situations délicieusement cocasses). En symbole même de cette ambivalence, le lac a véritablement une double fonction, à la fois de vie et de mort, de destruction et d'indulgence (inutile d'en dire trop ici...).
Deux autres faits à évoquer : d'abord la rareté des cartons explicatifs. Murnau ne les utilise en-effet que quand il ne peut vraiment pas faire autrement, persuadé que les images se suffisent à elles-mêmes : cette sacralisation de l'image sur les dialogues est le b-a ba du cinéma et il restera de mise lorsque le parlant arrivera.
A-propos de parlant : comme s'il était conscient que cette technique allait apparaître incessamment, Murnau l'anticipe et de belle manière en travaillant très soigneusement la bande-son, de manière à donner l'impression de véritables bruitages lorsque l'histoire s'y prête (le vent qui siffle, les klaxons dans les embouteillages, le coup de couteau sur un coup de cymbales...).
Ces trésors, pris isolément, rendraient n'importe quel film mémorable ; ensemble ils feraient un réservoir inépuisable pour chaque cinéphile et chaque professionnel du cinéma ; offerts par Murnau ils ont donné L'Aurore... Je ne vois aucun qualificatif pour désigner dignement ce film... Et son influence n'attendit même pas la fin de son tournage : Janet Gaynor et plusieurs techniciens étaient en-effet appelés sur un autre film dans le même studio, film où je vous invite à me suivre pour notre prochaine étape...
18 Re: Mon cinéma à-travers les temps Mer 20 Sep 2017 - 23:47
Re: Mon cinéma à-travers les temps Mer 20 Sep 2017 - 23:47
Sudena
L'Heure Suprême
Frank Borzage; 1927
Frank Borzage; 1927
Le mélodrame est un genre aux possibilités multiples mais aussi aux très nombreux pièges. Aussi a-t-on souvent vu les réalisateurs soit « biaiser » avec ses codes, soit donner à leurs films une dimension hyper-esthétique, soit le « mélanger » à un autre genre plus « noble ». Néanmoins, dans les années '20, le cinéma peine encore à être reconnu comme un art et respecte donc les codes stricts des genres pour ne pas risquer de perdre un public qu'on sait notoirement pusillanime (même si le terme est méchant...).
Frank Borzage, alors âgé de trente quatre ans, est un réalisateur à la trajectoire archi-classique pour l'époque : homme de spectacle, d'abord accessoiriste dans un théâtre puis émigrant à Hollywood, il se spécialise rapidement dans la réalisation et est engagé par la Fox au début des années '20. Le mélodrame, c'est sa passion : il adore les histoires d'amour et il sait bien les mettre en scène (alors qu'il éprouve vis à vis de la guerre et de l'uniforme en général une répulsion totale et absolue). En 1927, la Fox lui demande de réaliser un film comme il sait les faire en lui donnant pour les rôles principaux deux jeunes acteurs séduisants mais peu connus du grand public : Janet Gaynor et Charles Farrell. Le scénario, le voici : dans les bas-quartiers de Paris, Chico, égoutier rêvant de devenir balayeur des rues pour pouvoir travailler au soleil, sauve la vie de Diane, pauvre fille désespérée à la misère indigente battue comme plâtre par sa sœur. D'abord réticent, il finit néanmoins par l'amener chez lui pour qu'ils échappent à la police. Sa piaule est située au septième étage d'une mansarde, directement sous les étoiles, et Diane y voit un paradis habité par un ange de bonté (d'où le titre original du film : Seventh Heaven) : on devine aisément la suite... Mais nous sommes alors en 1914 : la guerre s'abat sur la France et Chico est contraint d'aller se battre dans les tranchées...ce qui n'empêche pas les deux amants de rester en contact quasi-télépathique et de se retrouver en pensée tout les jours à onze heures (l'heure où ils se sont quittés) : de là, leur amour va abolir les frontières de la logique physique et devenir plus fort que la mort même...
Ce scénario est, j'en conviens, assez désespérant en soi. Mais Borzage disposait de deux atouts qui devaient lui permettre de transformer ce matériau en une véritable ode à l'amour, ode qui subjugua les surréalistes (Breton en tête) : il croyait profondément au pouvoir de l'amour...et Freidrich Murnau réalisait L'Aurore juste avant lui, dans les mêmes studios, avec la même actrice principale et les mêmes techniciens. Il se rendit donc régulièrement sur ce tournage et observa attentivement le Maître en action, notant plusieurs idées qu'il devait réutiliser pour son propre film... Les cameramen, éclairagistes et autres chanceux qui travaillaient sur les deux films se servirent eux-aussi de l'expérience extraordinaire acquise au contact du génie allemand et la transformèrent en savoir-faire. Le style Borzage s'affirma à ce moment-là...ce qui, à bien y réfléchir, est véritablement unique : la carrière d'un réalisateur définitivement lancée grâce à un film qui n'est pas le sien et où il n'est intervenu à aucun moment. Quel as ce Murnau, décidément !..
Mais Borzage ne fut pas un banal imitateur et s'il se forma aux techniques via Murnau, il apporta son style propre à son film. La comparaison entre les deux fut donc inévitable et force est de reconnaître que L'Aurore la soutient favorablement : elle est beaucoup plus belle esthétiquement, beaucoup plus « riche » au niveau purement cinématographique (elle n'a pratiquement pas « vieilli » aujourd'hui), beaucoup plus universelle dans sa thématique... Mais L'Heure Suprême a aussi des qualités qui lui sont propres et qui feront tout le « style Borzage » par la suite : son propos, plus « direct », est donc aussi plus humain ; les acteurs, manifestement plus libres, personnalisent mieux leurs rôles et démontrent merveilleusement leurs qualités et leur complémentarité (jamais actrice n'a mieux symbolisé la tendresse que Gaynor...) ; les personnages secondaires ont des caractères plus marqués qui les rendent extrêmement attachants ; enfin la foi en l'amour du réalisateur transpire tout le temps et emporte tout sur son passage. Alors qu'on pourrait se croire dans un film « kitch », convenu et insupportable, nous nous retrouvons embarqués dans un fabuleux hymne à l'amour, tellement sincère et tellement prenant que nous le faisons nôtre, notre âme abolissant et asservissant notre raison. C'est ça, le génie de ce film, qui fait que même les plus hermétiques au mélodrame ouvriront de grands yeux et auront envie d'y croire !.. L'Heure Suprême est un bonheur qui abolit les frontières entre la raison et la passion, une ode aux sentiments par-delà les épreuves et un film d'un optimisme merveilleux _ probablement le meilleur de Borzage qui en a pourtant fait d'autres avec le même duo d'acteurs principaux _ .
19 Re: Mon cinéma à-travers les temps Jeu 28 Sep 2017 - 0:18
Re: Mon cinéma à-travers les temps Jeu 28 Sep 2017 - 0:18
Sudena
Octobre
Sergueï Eisenstein; 1927
Sergueï Eisenstein; 1927
Huit mois. C'est le temps qui s'est écoulé entre la chute du Tsar et l'arrivée au pouvoir des bolcheviques. Huit mois qui ont vu un gouvernement bourgeois, anti-tsariste mais modéré, mené par le socialiste Kerenski, prendre les rennes du pays...et s'aliéner le peuple au point de déclencher une deuxième Révolution qui eut raison de lui. De ces huit mois, avec en point d'orgue les dix jours décisifs allant du 16 au 26 octobre 1917, Eisenstein devait faire son film le plus attachant, le plus flamboyant et le plus génial à défaut d'être le plus parfait (peut-être pour des raisons extérieures à sa volonté, nous y reviendrons).
Si Octobre est, de façon visible, un Eisenstein, il est aussi l'un des plus difficiles d'abord. L'importance du montage et des images est immense mais il nécessite une bonne culture et/ou une capacité « sûre » d'immersion dans la fiction pour produire son effet...ce qui explique un accueil populaire un tantinet froid au vu des moyens engagés et de l'histoire racontée. D'un autre côté, c'est aussi ce pari qui a fait et sa réussite et son importance dans l'histoire du cinéma : les réalisateurs ont compris qu'on pouvait, dans un film, utiliser la puissance de la symbolique pour appuyer et exalter un propos, quitte à interrompre momentanément la narration à proprement parler.
Quelques exemples particulièrement frappants : la statue du Tsar, détruite au début du film, se reconstitue après la répression, par la Douma issue de la Révolution de février, des manifestations ouvrières, Douma elle-même enfermée dans la Palais d'Hiver de Petrograd : Eisenstein fait comprendre ainsi que rien n'a changé, que la tyrannie est toujours la même et que le Tsar a jute été remplacé par un collège de tyrans ambitionnant le pouvoir suprême... Encore plus cynique, l'image grotesque de Kerenski, d'abord ébloui par les pots de chambre de la famille tsariste, puis seul à son bureau, la caméra prenant juste son visage...avant de montrer en parallèle le buste de Napoléon 1er, l'angle de prise de vue montrant bien le côté bouffon de ce personnage dévoré par l'ambition...
Ces exemples ne sont que les plus frappants de ce film qui fonctionne en permanence de cette façon, parfois de façon encore plus subtile comme dans cette scène terrible où les quartiers ouvriers sont physiquement isolés du reste de Petrograd par un pont mécanique levé, le cadavre d'un malheureux manifestant coincé en haut avant de tomber dans la Néva. Il sait aussi prendre son temps, montrant l'espoir de paix des soldats mourant de froid progressivement déçu en ne filmant aucune action les concernant pendant plusieurs minutes (en revenant simplement « prendre la température » de temps en temps).
Mais, dans la dernière partie, l'action repart de plus belle avec une montée en puissance d'école : les réunions du Comité militaire révolutionnaire avec les débats qui s'enlisent entre les représentants des différents soviets en désaccord sur les moyens à employer mais où la frange révolutionnaire menée par Lénine finit par emporter l'adhésion tandis que le gouvernement de la Douma dort et laisse le Palais d'Hiver à un bataillon de femmes démotivées sont des scènes délicieusement palpitantes...qui auraient probablement été LE grand moment du film si la censure stalinienne ne s'en était pas mêlé et n'avait ordonné le retrait des scènes mettant en vedette Trotski, ce qui eut pour conséquence une certaine perte de clarté. Le savoir permet aussi de ne pas avoir de doutes sur les idéaux de Sergueï Eisenstein qui, s'il admirait éperdument Lénine, n'a jamais adhéré à un quelconque culte de la personnalité : les nombreuses scènes mettant en vedette les simples gens le prouvent...et il utilisa plusieurs fois ce procédé par la suite pour « biaiser » avec la censure (même _ surtout... _ dans les films archi-contrôlés par Staline et sa bande qui restent des chefs d'œuvre grâce au génie et à l'intelligence de son réalisateur [je pense en particulier à Alexandre Nevski]).
Doté d'une photographie éblouissante, d'un « souffle » et d'une beauté extraordinaires, Octobre se termine par LA scène du cinéma soviétique : l'invasion du Palais d'Hiver par les camarades communistes qui, telle la marée emportant tout sur son passage, déferlent sur l'ancien monde pour tenir les promesses nées de la Révolution de février qui étaient, alors, restées lettre morte : la paix ! le pain ! la terre !.. Cette scène est probablement celle qui m'a, tous films d'Eisenstein confondus, fait le plus vibrer... Car l'espoir est beau ! Car la promesse est grande ! Car ce souffle révolutionnaire a quelque-chose d'intemporel et d'universel !.. Et ça, nous le devons certainement à des réalisateurs comme Sergueï Eisenstein...
20 Re: Mon cinéma à-travers les temps Dim 1 Oct 2017 - 23:48
Re: Mon cinéma à-travers les temps Dim 1 Oct 2017 - 23:48
Sudena
Il est temps maintenant de reprendre le cours de notre voyage...et de constater que la route qui va nous amener vers le parlant est pour le moins fongueuse... Fin 1927, Le Chanteur de jazz sort enfin sur les écrans et la Warner rafle, d'un coup, tout le public qui se rue sur cette nouveauté, qui en demande encore et qui ne va plus jurer que par le parlant. Seulement, cette révolution inattendue prend de court l'ensemble de l'industrie et les cinéastes doivent désormais intégrer la dimension sonore dans leurs films...ce qui a des conséquences non-négligeables sur la qualité desdits films. En-effet, entre la caméra, le brouhaha des plateaux, les voix des acteurs i tutti quanti, tout doit être « recalibré » et les ingénieurs du son prennent le pouvoir dans les studios. Sauf que ces gens ne connaissent rien au cinéma, imposent des moyens draconiens et absurdes comme enfermer la caméra dans une salle insonorisée, exaspèrent les réalisateurs et laissent les producteurs démunis...
Les décideurs, eux, n'ont que faire de ces problèmes : le public demande des films parlants, il faut lui servir des films parlants, point ! En Amérique, les tensions deviennent rapidement palpables : des stars comme Chaplin, Pickford ou Fairbanks refusent tout simplement de se soumettre à ce diktat et continuent en « free-lance », quitte à payer leurs films de leur poche. A-contrario, certaines comme Swanson, moins polyvalentes, sont purement et strictement oubliées, faute de savoir évoluer. D'autres réussissent à passer au parlant sans trop de difficulté (comme Charles Farrell et Janet Gaynor ou les comiques Laurel et Hardy)... Mais tout se fait de façon pénible, venimeuse, parfois brutale et les studios n'ont aucune pitié envers ceux qui essaient de résister, particulièrement la Paramount et la Fox qui veulent très vite des résultats...et dont la qualité des films va decrescendo ce qui, à terme, risque de leur être préjudiciable (surtout pour la Fox : la Paramount, beaucoup plus riche, a une certaine tranquillité financière). Furieux, Murnau, qui avait pourtant déjà anticipé le parlant et semblait prêt à lui donner sa légitimité, claque la porte : il tient à son style et est bien décidé à l'imposer, quitte à reculer pour mieux sauter. On verra ce qu'on verra... La MGM, elle, se met rapidement en danger à force de se défier de cette nouveauté : son conservatisme va pourtant, paradoxalement, l'empêcher de commettre certaines âneries et lui permettra, dans l'ombre, d'affirmer son style pour les années à venir...
En Europe, les passions sont moindres mais l'exigence du public demeure réelle. Certains réalisateurs décident alors d'un compromis assez intelligent : faire des films parlants...mais sans renoncer aux cartons et en faisant de cette technique un simple « pis-aller » sans importance sur le film lui-même. Ce choix est celui d'un film qui sera l'étalon cinématographique d'un mouvement artistique dont nous avons déjà parlé : le surréalisme.
Les décideurs, eux, n'ont que faire de ces problèmes : le public demande des films parlants, il faut lui servir des films parlants, point ! En Amérique, les tensions deviennent rapidement palpables : des stars comme Chaplin, Pickford ou Fairbanks refusent tout simplement de se soumettre à ce diktat et continuent en « free-lance », quitte à payer leurs films de leur poche. A-contrario, certaines comme Swanson, moins polyvalentes, sont purement et strictement oubliées, faute de savoir évoluer. D'autres réussissent à passer au parlant sans trop de difficulté (comme Charles Farrell et Janet Gaynor ou les comiques Laurel et Hardy)... Mais tout se fait de façon pénible, venimeuse, parfois brutale et les studios n'ont aucune pitié envers ceux qui essaient de résister, particulièrement la Paramount et la Fox qui veulent très vite des résultats...et dont la qualité des films va decrescendo ce qui, à terme, risque de leur être préjudiciable (surtout pour la Fox : la Paramount, beaucoup plus riche, a une certaine tranquillité financière). Furieux, Murnau, qui avait pourtant déjà anticipé le parlant et semblait prêt à lui donner sa légitimité, claque la porte : il tient à son style et est bien décidé à l'imposer, quitte à reculer pour mieux sauter. On verra ce qu'on verra... La MGM, elle, se met rapidement en danger à force de se défier de cette nouveauté : son conservatisme va pourtant, paradoxalement, l'empêcher de commettre certaines âneries et lui permettra, dans l'ombre, d'affirmer son style pour les années à venir...
En Europe, les passions sont moindres mais l'exigence du public demeure réelle. Certains réalisateurs décident alors d'un compromis assez intelligent : faire des films parlants...mais sans renoncer aux cartons et en faisant de cette technique un simple « pis-aller » sans importance sur le film lui-même. Ce choix est celui d'un film qui sera l'étalon cinématographique d'un mouvement artistique dont nous avons déjà parlé : le surréalisme.
21 Re: Mon cinéma à-travers les temps Jeu 12 Oct 2017 - 23:35
Re: Mon cinéma à-travers les temps Jeu 12 Oct 2017 - 23:35
Sudena
L'Âge d'or
Luis Bunuel; 1930
Luis Bunuel; 1930
Le rêve. C'est sur le rêve que se base intégralement le surréalisme, art de l'inconscient, des fulgurances et des passions qui se veut l'aboutissement artistique des théories de Sigmund Freud, tout en assumant et en revendiquant ses origines au parfum de scandale qu'ont été Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire ou, a-fortiori, Sade.
En-revanche, pourtant passionnés de cinéma, les surréalistes ne se sont jamais beaucoup investis dans cet art, probablement parce que la manière de le créer, nécessairement longue et fastidieuse, correspondait mal à leur idéal d'écriture automatique et d'improvisations sans recherche « directe » de sens. Néanmoins, cette forme d'expression avait un atout de poids à leurs yeux : sa puissance, conduisant rapidement à cet état hypnotique où toutes les transgressions sont permises vu qu'elles ne peuvent être « qu'intérieures ». Or, les surréalistes ont toujours vomi la morale judéo-chrétienne et les fausses valeurs bridant l'esprit et paralysant le génie. La société bourgeoise, l’Église et tout ce qui s'y raccroche étaient donc leurs pires ennemis, ennemis qu'ils ont toujours attaqué « de front », sans se cacher derrière un quelconque discours à double-entente : profondément gauchistes, anti-colonialistes, ne cachant pas leurs paradoxes très « humains » et assumant une sexualité libre (Breton révèle son homosexualité dans une phrase simple et magnifique du Manifeste [« Vaché est surréaliste en moi »]), ils étaient les vrais rebelles des Années Folles et très peu, depuis, ont eu à la fois leur intransigeance morale et leur courage intellectuel...
Luis Bunuel est le seul cinéaste qui ait vraiment fait partie de ce mouvement. En 1929, il réalisa, aidé par Salvador Dali, Un Chien andalou, court-métrage où il n'est jamais question de chien ni d'Andalousie et qui, avec une énergie frénétique, illustre tous les principes du surréalisme (anti-cléricalisme, désir dévorant, destruction par la pourriture interne, etc...). Principal coup de force de ce film, l'invention du premier effet gore avec cet œil tranché en gros plan par une lame de rasoir.
Désormais reconnu, Bunuel obtient un budget considérable grâce au mécénat pour tourner cette fois-ci un long métrage : il en fera le plus grand film de sa pourtant prolifique carrière et LE film surréaliste par-excellence.
L'Âge d'or commence, de façon tout à fait déroutante, par un reportage sur les scorpions. Puis nous suivons un bandit traqué se réfugiant dans une cabane en bord de mer, tandis que sur la falaise trois évêques semblent attendre on ne sait quoi (on les reverra vite, dans la même position...mais réduits à l'état de squelettes...)... Ces histoires cessent aussi vite qu'elles ont commencé et nous sommes amenés soudain à voir un personnage vraiment détonnant : un riche monsieur jetant injures et insanités à la face d'une foule assemblée pour une quelconque inauguration tout en assouvissant ses passions avec une jeune femme aussi « active » que lui. Nous apprendrons par la suite que cet homme est un ambassadeur respecté qui se rend à une soirée mondaine, soirée où il retrouvera son amante...sans perdre un iota de sa liberté... Pulsions, images allégoriques diverses, provocation, liberté : telles sont les obsessions de ce film déroutant et hypnotisant qui ne cherche jamais à plaire mais qui surprend en permanence en illustrant visuellement la plus petite et la plus inavouable idée qui nous effleure à un instant T.
Deux exemples parmi d'autres : lors de la scène dans le boudoir où la jeune femme discute avec sa corpulente et agaçante mère, apparaît soudain une grosse vache allongée sur le lit (l'humour noir est probablement la forme d'expression la plus utilisée dans le film). Plus méchante encore : la scène où un père tue d'un coup de fusil son fils qui l'énerve dans l'indifférence totale des bourgeois rassemblés dans la pièce du haut.
Provoquant un scandale à sa sortie, honni par l'extrême droite et les ligues chrétiennes, ce film fut censuré peu après sa sortie et il fallut attendre 1981 et la victoire de la gauche aux présidentielles pour qu'il soit de nouveau diffusé en France (au moins fut-ce du vivant du réalisateur...). Une telle haine puise certainement sa source dans la dernière scène, qui rompt totalement avec l'histoire précédente et qui montre le Christ sortant apaisé et souriant d'une orgie sanglante... Irrésistiblement drôle et délicieusement « sadienne », cette scène est, à mon sens, celle qui a fait la différence entre le grand film, que L'Âge d'or aurait été sans elle, et le chef d'œuvre qu'il est et qu'il restera par-delà les âges et les arts...
L'Âge d'or est le film le plus libre que j'aie jamais vu, certainement pas le plus beau mais l'un des plus marquants. Aujourd'hui, il reste le père et la référence de tout film dérangeant ou provoquant : très peu d'autres peuvent revendiquer un tel héritage !..
22 Re: Mon cinéma à-travers les temps Jeu 19 Oct 2017 - 22:08
Re: Mon cinéma à-travers les temps Jeu 19 Oct 2017 - 22:08
Sudena
Après cette escale dans les nuages, nous allons redescendre sur terre...ou presque. Car, désormais, Freidrich Murnau est prêt ! Il a passé plus d'un an dans les îles du Pacifique et ce qu'il en a ramené est totalement déroutant... C'est donc aux confins du monde et de la raison que je vous invite à le retrouver...
23 Re: Mon cinéma à-travers les temps Jeu 19 Oct 2017 - 23:25
Re: Mon cinéma à-travers les temps Jeu 19 Oct 2017 - 23:25
Sudena
Tabou
Freidrich Murnau; 1931
Freidrich Murnau; 1931
Une île paradisiaque, des coutumes exotiques, un couple tragique : d'emblée les attraits et curiosités ne manquent pas pour ce film joué, qui plus est, par des acteurs locaux, souvent non-professionnels... Tout ça est bien joli, certes, mais le soupçon peut rapidement naître aussi : ne va-t-on pas voir un film colonialiste, condescendant envers les peuples mis en scène, ou au-contraire sombrer dans l'idéalisme rêveur propre à la culture tiki qui commence à cette époque en Amérique ?.. La meilleure réponse que je pourrais donner serait : « Il s'agit d'un Murnau, s'il vous plaît... » Réponse évidente, un rien suffisante peut-être, mais je n'en ai pas de meilleure en restant simple...
Développons un peu : parti se ressourcer en Polynésie, Freidrich Murnau y a découvert les peuples Maoris et il a décidé de les mettre vraiment à l'honneur sans pour autant ni faire montre d'une admiration béate et bêlante, ni réaliser un documentaire. Il reste un conteur et il sait que la meilleure façon de rapprocher les peuples est de montrer en action la chose commune à tous les êtres humains : les sentiments.
Aussi Tabou est-il construit à la manière d'un mélodrame : sur l'île de Bora-Bora, le jeune pêcheur Matahi s'éprend d'une fille nommée Reri. Mais Reri est alors choisie pour servir les dieux, devenant ainsi « taboue » pour les humains. L'inquiétant sorcier Hitu est chargé d'y veiller... Mais Matahi refuse cette décision et décide d'enlever Reri, elle-même amoureuse de lui, quitte à s'attirer les foudres du sorcier... Pour fuir les représailles et vivre leur amour, les deux jeunes gens s'enfuient et trouvent refuge dans la communauté hétéroclite de Tahiti où Matahi se fait remarquer pour ses talents de pêcheur de perles...tout en s'endettant, ignorant la valeur et la puissance de l'argent. Les amants vivent néanmoins heureux...mais Hitu est toujours sur leurs traces et finit par les retrouver...
A-partir de ce scénario, Murnau livre un film aussi étrange qu'hypnotisant, divisé en deux parties intitulées de façon lapidaire « Le paradis » et « Le paradis perdu ». Il y montre toute l'étendue de son talent en faisant évoluer non-pas seulement l'intrigue mais aussi l'ambiance au fur et à mesure de l'avancée du film... Dans la première partie, tout est ensoleillé, comme enchanté, et la caméra semble presque voler ces moments de joie et de détente... Ce naturalisme et le temps passé à contempler simplement cette joie de vivre ferait presque oublier l'excellence de la photographie (du français Émile Savitry) et donner une impression de quiétude un rien ennuyeuse...en apparence. Car déjà pointe LE grand coup de ce film unique : l'absence de cartons explicatifs.
Murnau a réussi ce pari impossible ! Sa manière de filmer les émotions, la force évocatrice de son cadrage et de ses ambiances, permettent de se passer de cet artifice que le parlant semblait devoir abolir : le génie allemand a réussi a faire LE film muet ultime ! Et quand les explications sont indispensables, il reprend une des multiples inventions de Griffith : il intègre l'écrit au récit par une proclamation lue en public ou un rapport de police officiel. C'est aussi simple que limpide...
Mais, dans la deuxième partie, plus longue et beaucoup plus sombre, l'expressionniste se réveille : les scène nocturnes se multiplient, les apparitions de Hitu, aussi brèves qu'effrayantes, plongent le film dans le surnaturel, la symbolique des décors prend une dimension nouvelle jusqu'à la couleur des deux perles que Matahi trouvera (je n'en dirai pas plus ici). Le sens du montage exceptionnel du Maître crée un suspense indissociable de l'émotion avec un crescendo terrible qui, jusqu'au bout, refuse de « dévoiler ses cartes » quant à sa conclusion qu'on sent prête à basculer à chaque instant...
Mystérieux et merveilleux film, Tabou, réalisé aux frais du réalisateur, envoûta et enchanta les studios qui s'arrachèrent les droits de diffusion : Freidrich Murnau avait gagné ! Son talent, son courage et son instinct lui avaient permis de revenir dans le grand bain hollywoodien et d'imposer sa volonté sans concession artistique. Contrairement à Griffith qui perdait une grande partie de son talent en essayant d'apprivoiser « de force » une technique qui ne lui était pas familière, le parlant tendait les bras au maître allemand qui n'allait pas tarder à lui donner son premier vrai chef d'œuvre. C'était certain ! C'était écrit !..
24 Re: Mon cinéma à-travers les temps Ven 20 Oct 2017 - 21:33
Re: Mon cinéma à-travers les temps Ven 20 Oct 2017 - 21:33
Sudena
Freidrich Murnau a-t-il violé des sites sacrés pour tourner son film ? S'est-il attiré la colère des dieux maoris comme l'a affirmé le sorcier Hitu ?.. Toujours est-il que le tournage de Tabou a été endeuillé par plusieurs accidents et morts tragiques, ce qui, dans ce contexte marqué par l'avalanche de morts violentes suivant la découverte du tombeau de Toutankhamon par lord Carnarvon et Howard Carter en 1922, a alimenté les rumeurs diverses de malédictions et de vengeances ésotériques... Le 11 mars 1931, Freidrich Murnau semble à son tour frappé par la malédiction : il meurt dans un accident de voiture, âgé de seulement 42 ans...
Dès lors le cinéma semble condamné à adopter le parlant comme une nécessité, d'accepter sa réalité davantage qu'un potentiel artistique dont beaucoup doutent...
C'est d'Allemagne que viendra le miracle. D'un réalisateur déjà connu et reconnu, qui a fait ses premières armes sur Caligari et qui s'est imposé depuis comme l'un des maîtres de l'expressionnisme, quoiqu'il ait toujours refusé ce statut. C'est lui qui fera du parlant une condition sine qua non de la qualité de son futur film, film qu'il soigna aux petits oignons et qui s'imposa comme le premier méga-chef d'œuvre du cinéma parlant. C'est lui que je vous invite à retrouver pour la dernière escale de ce premier continent. Il s'appelle Fritz Lang et il va, en cette tragique année 1931, nous offrir M le Maudit...
Dès lors le cinéma semble condamné à adopter le parlant comme une nécessité, d'accepter sa réalité davantage qu'un potentiel artistique dont beaucoup doutent...
C'est d'Allemagne que viendra le miracle. D'un réalisateur déjà connu et reconnu, qui a fait ses premières armes sur Caligari et qui s'est imposé depuis comme l'un des maîtres de l'expressionnisme, quoiqu'il ait toujours refusé ce statut. C'est lui qui fera du parlant une condition sine qua non de la qualité de son futur film, film qu'il soigna aux petits oignons et qui s'imposa comme le premier méga-chef d'œuvre du cinéma parlant. C'est lui que je vous invite à retrouver pour la dernière escale de ce premier continent. Il s'appelle Fritz Lang et il va, en cette tragique année 1931, nous offrir M le Maudit...
25 Re: Mon cinéma à-travers les temps Jeu 2 Nov 2017 - 21:58
Re: Mon cinéma à-travers les temps Jeu 2 Nov 2017 - 21:58
Sudena
M le Maudit
Fritz Lang; 1931
Fritz Lang; 1931
La réputation de Fritz Lang, au moment où sort son premier film parlant, n'est déjà plus à faire, et ce depuis longtemps. Son style, mélangeant habilement baroque, futurisme et expressionnisme, lui a permis de réaliser de grandes fresques fantastiques comme Les Nibelungen, directement inspiré par la fameuse « Tétralogie » de Wagner (L'Or du Rhin, La Walkyrie, Siegfried, Le Crépuscule des Dieux), ou le beaucoup plus venimeux Docteur Mabuse mettant en scène un manipulateur hypnotiseur réduisant en esclavage ceux qui le côtoient avant d'être lui-même pris au piège de ses ambitions qui le conduiront à sa chute. Dans la même veine, il réalise en 1927 l'inquiétant Metropolis : film de science-fiction hautement métaphorique de la lutte des classes où il fait part d'une inquiétude non-dissimulée vis à vis de l'évolution technologique de l'industrie...tout en reprenant l'esthétique du mouvement qu'il dénonce indirectement : le futurisme.
Ces films ont plusieurs points communs : l'expressionnisme, d'une part, y est omniprésent tant dans les images que dans le message distillé et il faudra beaucoup de temps au réalisateur pour en sortir définitivement (peut-être précisément parce qu'il en a toujours minimisé l'impact). D'autre part ils sont extrêmement « précis » dans les cadrages, le jeu des acteurs, la longueur (souvent importante)... Précis...pour ne pas dire « rigides »...
Fritz Lang n'a pas, en-effet, le génie pur et insolent d'un Murnau, d'un Griffith ou d'un Eisenstein : il est plus « formel », plus attentif aux petits détails (du moins de façon plus visible), moins instinctif aussi... Ça a aussi ses avantages : ses films ne sont jamais « bâclés », ne prennent pas le public à contre-pied et tiennent toujours leurs promesses. De plus, son grand professionnalisme rassure les décideurs qui savent qu'il ne se lancera jamais dans une quelconque aventure à la légère (ça persistera tout au long de sa carrière : Fritz Lang fait partie de ces réalisateurs rares qui ne déçoivent jamais quand on regarde un de leurs films...). Aussi, lorsqu'on apprend qu'il est en train de réaliser un film parlant, les sourcils se lèvent et les oreilles se tendent : un tel type a certainement autre-chose en tête que plaquer des mots interchangeables sur des images banales !.. Qui sait ? ça va peut-être donner le chef d'œuvre qu'on attend maintenant depuis cinq ans...
La première idée géniale de M le Maudit est certainement son scénario : un tueur en série pédophile sévit dans une grande ville d'Allemagne et nargue la police. Ce criminel, joué par un étourdissant Peter Lorre, apparaît pourtant progressivement aussi victime que bourreau, prisonnier de ses obsessions et incapable de maîtriser ses pulsions... La police se casse les dents, cherche des indices partout, la psychose s'installe dans la population qui voit le coupable à chaque coin de rue, tout le monde soupçonne tout le monde...mais les plus furieux sont les bandits, mendiants, prostituées et autres marginaux qui, avec les contrôles incessants, ne peuvent plus rien faire et qui décident de se lancer eux aussi sur les traces de ce tueur...
Ce scénario va permettre à Fritz Lang d'utiliser le parlant pour en faire un véritable élément dramatique sans pour autant négliger le côté purement visuel de son film, visuel qui se manifeste par ces montages implacables en plans souvent fixes pour marquer en premier lieu la disparition de la fillette victime de M (l'horloge, la chaise vide, le ballon abandonné...), puis pour illustrer les plans, interrogations...et parfois mensonges des policiers (particulièrement dans la scène où ils font croire au voleur pris sur le fait qu'un gardien a été tué...alors qu'on voit ce même gardien se régaler au même moment d'un imposant verre de bière). L'image marque aussi les rapports de force en exagérant volontairement la plongée ou la contre-plongée pour les symboliser de façon très « visible ». Mais c'est certainement la façon de montrer M qui rend ce film visuellement inoubliable : outre la marque laissée sur lui par les mendiants afin que les bandits puissent l'identifier, il est, au fil du film, de plus en plus « désigné » par le décor qui soit le pointe soit l'encadre, mais qui ne lui laisse aucun échappatoire. Ce côté pathétique est contrebalancé par ses apparitions aux moments où ses pulsions le transforment en prédateur, apparitions où il semble se fondre dans l'ombre...en sifflant une fameuse mélodie de Grieg...
Car c'est cette mélodie qui reste le plus dans nos mémoires une fois qu'on a vu M le Maudit : tiré du quatrième mouvement de Peer Gynt (« Dans l'antre du roi de la montagne »), cet air obsédant et effrayant a pour nous l'effet d'un signal de danger imminent, de basculement dans la folie... Mais ce n'est que le son le plus marquant du film, certainement pas le seul !.. Se passant de tout bruitage superflu, Fritz Lang marque ainsi parfaitement les contrastes entre le calme parfois oppressant et les moments de bruits stridents qui agressent vraiment l'oreille, dont la foule paniquée...ou les accusations finales du procès improvisé par les bandits où l'ire de la masse semble presque plus folle et plus criminelle que le tueur hurlant son impuissance tandis que son avocat essaie de placer chacun face à ses responsabilités...et de démontrer qu'on ne peut juger un homme atteint d'une maladie mentale !.. Ce courage moral impressionnant place clairement Lang en porte à faux vis à vis du Parti Nazi, de plus en plus populaire dans l'Allemagne de cette époque (il ne tardera pas à s'exiler en Amérique pour fuir les représailles).
Pour en revenir sur le son, remarquons qu'il sert aussi à un pan très original et particulièrement attachant du film : son humour très fin et très subtil qui l'allège très salutairement. Parmi les séquences de ce type, une porte directement sur l'ouïe : la logeuse dure d'oreille de M qui exaspère les policiers tant par sa surdité que par certains excès de zèle qui perturbent leur travail. Un autre moment mémorable est la recherche nocturne de M par les bandits dans des bureaux déserts, toute de légèreté mais remarquable de suspense...et qui se termine presque en gag avec la capture du cambrioleur plein d'humour et sympathique Franz, impeccablement joué par Freidrich Gnass...
Le seul défaut qu'on pourrait trouver à ce film est, précisément, cette rigidité propre au style de Lang qui l'a assez mal fait supporter l'épreuve du temps. Une autre déception vient de sa fin, totalement « expédiée » par un montage ultra-rapide qui laisse dans l'expectative sans pour autant choisir délibérément de rester suspensif... Cette réserve mise à part, M le Maudit demeure un modèle de film qui a atteint son objectif : légitimer le parlant au cinéma, ce qui va nous permettre de laisser derrière nous ce premier continent pour voguer sereinement vers le deuxième, le plus imposant et le plus important de ce monde à-travers mes yeux : celui de l'âge d'or de cet art...
Aller à la page : 1, 2, 3 
Sujets similaires
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum