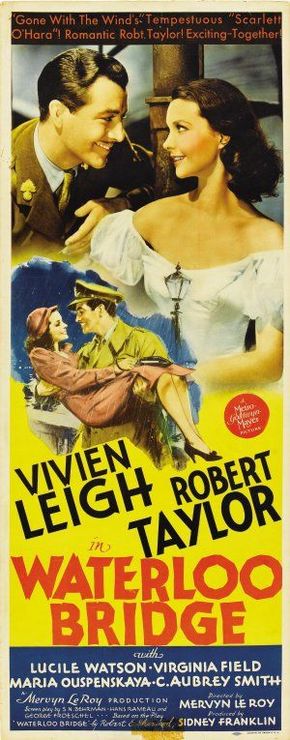L'Impossible Mr Bébé
Howard Hawks; 1938

« Polyvalent » est sans aucun doute le qualificatif le mieux approprié pour définir Howard Hawks. Ce réalisateur fait partie des génies du cinéma, mais un génie des plus singuliers en ce sens où il n'est ni un inventeur, ni un esthète, ni un iconoclaste : sa caméra est toujours posée à hauteur d'homme, sans effet de style particulier, et si l'image est toujours très soignée elle ne se perd jamais en virtuosité « gratuite ». De même, Hawks n'invente aucun genre, ni n'en travestit en aucune façon : il respecte les codes à la lettre et n'explore jamais de terrains inconnus. Seulement, Hawks est un génie ! un vrai !.. Car, d'une part, il n'y a pas un genre où il ne s'est pas aventuré (exception faite du documentaire), mais surtout _ et là est son génie _ il n'y a pas un genre à qui il n'a pas donné un chef d'œuvre qui figure dans tout canon digne de ce nom (un « canon » est un ensemble d’œuvres- « phares » d'un genre donné dont la réussite est admise par l'ensemble des critiques et de la profession). Film de gangsters, western, musical, comédie, horreur, film de guerre, péplum : rien ne lui a résisté et il écœurait les spécialistes qui se voyaient donner des leçons par ce type qui en était parfois à son coup d'essai et qui changeait tout son matériau de base en or...
C'est à la RKO qu'il peut le mieux s'exprimer (même si son talent lui laisse une grande liberté pour « voyager » parmi les Majors) et c'est là qu'il réalise, en 1932, le plus typique et le plus important film de gangsters de l'époque, sinon de l'histoire du septième art :
Scarface, où le personnage principal (interprété par Paul Muni) est si ouvertement inspiré par Al Capone que le film est dans un premier temps interdit dans toutes les villes contrôlées par la Mafia (dont Chicago) avant de passer, bon gré mal gré, bénéficiant de l'engouement du public...et d'Al Capone lui-même.
Désormais reconnu, Hawks poursuit sa carrière avec succès et explore de plus en plus les possibilités de la comédie. En 1938, il a les mains libres pour diriger les deux acteurs-phares de la RKO, qui se connaissent et jouent ensemble depuis trois ans : Cary Grant et Katharine Hepburn. Il fera de son film le sommet de la screwball-comedy...
L'Impossible Mr Bébé est à l'image de son réalisateur : un film archi- « codifié », avec une caméra à hauteur d'homme et aucun message politique sous-jacent (en apparence car, comme nous allons le voir, c'est un peu plus subtil que ça...), mais qui apporte un aboutissement complet et parfait au genre qu'il représente. Voici son synopsis : David (Cary Grant) est un paléontologue réputé et coincé qui, le même jour, doit à la fois se marier avec son austère secrétaire, récupérer le dernier os qui manque à son squelette de dinosaure...et convaincre, via son avocat, une riche dame de donner un million de dollars pour soutenir son musée. Pour ce, il dispute une partie de golf avec ledit avocat et s'arrange pour perdre. Il s'y arrange tellement bien qu'il envoie la balle sur le fairway voisin où celle-ci est jouée par une femme. Il va alors la voir pour lui signifier sa méprise...mais découvre en elle un moulin à paroles avec qui il est impossible d'aligner deux mots. Quelques instants plus tard, alors qu'il a renoncé à récupérer sa balle, il voit la jeune femme au volant de sa propre voiture en train d'essayer de quitter le parking en bousculant allègrement les autres véhicules. En tentant, paniqué, de limiter les dégâts, il se retrouve arraché à sa partie de golf sous l'œil hagard de l'avocat... Néanmoins il a encore le dîner pour rattraper la chose. Mais, dans le restaurant se trouve également la jeune femme... Prénommée Susan (et jouée, vous l'auriez compris, par Katharine Hepburn), celle-ci se persuade alors que David la suit à la trace et est, en fait, fou-amoureux d'elle. Le film est définitivement lancé : entre cette certitude et la course contre la montre de David va naître un florilège de situations plus délirantes les unes que les autres dont le catalyseur sera un cadeau envoyé à Susan par son frère et qui donne son nom au film : un léopard apprivoisé nommé Bébé...
Les gags de ce film se comptent par centaines mais, contrairement à un Laurel et Hardy, un Buster Keaton, un Marx Brothers ou un Charlie Chaplin, il est très difficile d'en isoler un en particulier vu que tous sont étroitement liés les uns aux autres et ne prennent toute leur saveur qu'intégrés à la continuité de l'intrigue. Et c'est là que réside certainement le premier coup de génie de
L'Impossible Mr Bébé : derrière son rythme infernal et ses personnages plus fêlés les uns que les autres (sur lesquels nous reviendrons dans peu de temps), Hawks maîtrise parfaitement son film, en particulier sa progression dramatique : il « jongle » génialement entre les différentes intrigues pour tout à la fois varier les gags et les amener vers le point convergeant où
toutes se dénoueront en même temps : un commissariat du Connecticut où toutes les folies vont se heurter les unes aux autres pour finalement faire triompher l'altruisme aux dépends des instincts, que ceux-ci soient bestiaux ou citoyens.
Quand je parle d'instincts « bestiaux », il faut concevoir l'expression au sens propre du terme.
L'Impossible Mr Bébé est un film doté d'un des plus riches bestiaire du cinéma, que ce soit dans le nombre ou dans l'importance des animaux y intervenant... Quoique inanimé, le squelette du dinosaure est le but et la base des actions de David et la recherche de son os occupe toute la deuxième moitié du film. Elle signe aussi le moment où Susan commence à mettre un coup de frein à son égocentrisme et à aider réellement David : ses actions, tout aussi loufoques que précédemment, prendront du même coup un sens plus touchant... Joué par un léopard nommé Nissa, dont l'amitié avec Katharine Hepburn est l'une des anecdotes de tournage les plus connues de l'époque, Bébé est une adorable boule de poils, joueur et sensible à la musique (la scène où Cary Grant et Katharine Hepburn chantent pour lui et où il fait les chœurs est aussi cocasse que fascinante) qui tout à la fois représente la gentillesse et l'ouverture naturelle à l'autre et qui, ainsi que le signifie son nom, réunit Susan et David dans un rôle de parents qu'ils doivent assumer...et qui va beaucoup les aider à « s'apprivoiser » mutuellement. À son total opposé il y a un autre léopard, totalement sauvage et inapprochable, qui symbolise le danger et l'hostilité de la nature incontrôlée. C'est lui que Susan capturera par erreur à la fin, obligeant David à déployer des trésors de patience et de courage pour réussir à l'enfermer. On peut ainsi voir que les léopards sont les pendants animaux du personnage de Susan qui évoluera progressivement de la sauvagerie pure et brute à la gentillesse naïve quoique imprévisible de Bébé... Et, en sens inverse, George le fox-terrier est, lui, le pendant animal de David : parfaitement urbain et domestiqué en apparence, on le découvre capable de toutes les bêtises du monde lorsqu'il vole l'os de David et qu'il s'aventure sans vergogne dans la forêt, avec en point d'orgue son amitié indéfectible avec Bébé (ils iront, lors de la scène finale, s'enfermer dans le même cachot pour échapper au léopard sauvage, de la même façon que Susan et David termineront ensemble, au sommet du squelette de dinosaure démoli).
Ce bestiaire et ses échos tendent à relativiser l'apparente légèreté du film, d'autant plus que les personnages humains ne sont pas oubliés, loin s'en faut. On pourrait d'ailleurs se demander si l'intrigue animale n'est pas, en fait, infiniment plus « raisonnable » que l'intrigue humaine... Dans
L'Impossible Mr Bébé, en-effet, tous les personnages (ou presque) sont fous et le film utilise les heurts de ces différentes folies pour alimenter sans discontinuer ses divers gags. Susan et David représentent les deux extrêmes du comportement humain. David est un « homo œuconomicus » complet : poli, urbain, qui étouffe complètement son caractère au nom des conventions sociales et qui n'agit que de façon réfléchie...jusqu'à ce qu'il se libère au contact de Susan qui, elle, est, de façon tout aussi extrême, l'archétype de « l'homo erectus », toute d'instinct, de fulgurances et qui prend sans jamais réfléchir au qu'en dira-t-on...ni à la volonté de l'autre (cet égocentrisme, qui, comme on l'a vu, s'assouplira au fil du film, demeure néanmoins délicieux tant il est « enfantin » et innocent). On peut observer que ce schéma renverse le rapport masculin/féminin traditionnel : dans
L'Impossible Mr Bébé, le personnage « phallique » est bel et bien Susan. C'est elle qui, à force de persévérance et d'audace, percera la carapace de David et le fera se rendre compte de ses sentiments, sentiments qu'elle-même éprouve depuis la scène du restaurant et dont elle mesurera, assez surprise, l'intensité dans la forêt. Plus que leurs gaffes et cette loufoquerie permanente, c'est cet amour qui fait qu'on ne peut jamais oublier
L'Impossible Mr Bébé après l'avoir vu : les sentiments sont la limite de tout art, la seule chose avec laquelle on n'a pas le droit de tricher, et Hawks l'a très bien compris, qui les utilise d'autant plus finement qu'on ne s'aperçoit que rétrospectivement de leur importance...
Les autres personnages sont tout aussi fous et inoubliables en soi mais la palme revient, selon moi, à un personnage qu'on ne voit que quelques secondes, qui dit en tout et pour tout trois mots avec un calme olympien, mais qui, ce faisant, provoque un fou-rire inextinguible : le facteur apportant son os de dinosaure à David pendant que celui-ci est au téléphone (je n'en dirai pas plus ici). Les seuls qui échappent à cette folie et qui se débattent au milieu d'elle sans, bien évidemment, réussir à rendre l'ensemble moins déjanté sont, de façon aussi fine qu'hilarante, le psychologue et sa femme. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces deux personnages qui, de par précisément leur normalité, rendent visible la folie furieuse des autres (comme le mouvement ne peut se concevoir que par-rapport à un point fixe pour ne pas devenir chienlit)...
Ces différentes richesses ne doivent pas pour autant diminuer le plaisir pur et unique que procure perpétuellement
L'Impossible Mr Bébé : film au rythme si frénétique qu'il en deviendrait presque épuisant mais qui demeure l'un des plus drôles de tous les temps et une cure de bonheur intarissable à chaque revoyure, porté par un Cary Grant et une Katharine Hepburn plus tordants et plus complices que jamais. Si, par principe, je me méfie des classements et des jugements de valeur, je peux néanmoins dire qu'il prétend largement au titre de meilleure comédie de tous les temps...